 Au temps du fleuve Amour d’Andreï Makine.
Au temps du fleuve Amour d’Andreï Makine.
Folio, octobre 1996, 272 pages, plus au catalogue de cet éditeur depuis 2017, ISBN 978-2-07-040062-X.
Genres : littérature franco-russe, roman.
Andreï Makine (Андрей Ярославович Макин, Andreï Yaroslavovitch Makine) naît le 10 septembre 1957 à Krasnoïarsk en Sibérie. Il apprend le français dès l’âge de 4 ans avec une vieille dame puis durant ses études. Il étudie la littérature française contemporaine à l’université de Kalinine (ou Tver) puis à l’université de Moscou et devient professeur de philologie à l’Institut pédagogique de Novgorod. Il s’installe en France en 1987, demande l’asile politique et est naturalisé Français. Il enseigne, devient écrivain et reçoit de nombreux prix littéraires. Depuis 2016, il est à l’Académie française.
 « […] pourquoi l’un de nous avait-il été propulsé sous des blocs de glace, dans la débâcle effrénée d’un grand fleuve qui avait broyé son corps, le rejetant irrémédiablement mutilé ? Tandis que l’autre, moi… Oui, je murmurais le nom de ce fleuve – Amour – en plongeant dans sa sonorité fraîche comme dans un corps féminin rêvé, conçu d’une même matière souple, douce et brumeuse. » (p. 16).
« […] pourquoi l’un de nous avait-il été propulsé sous des blocs de glace, dans la débâcle effrénée d’un grand fleuve qui avait broyé son corps, le rejetant irrémédiablement mutilé ? Tandis que l’autre, moi… Oui, je murmurais le nom de ce fleuve – Amour – en plongeant dans sa sonorité fraîche comme dans un corps féminin rêvé, conçu d’une même matière souple, douce et brumeuse. » (p. 16).
Le narrateur, Dimitri (que ses amis appellent Juan), et Outkine (qui vit maintenant de l’autre côté de l’Atlantique) ont grandi dans un village de Sibérie, près de la taïga et du tumultueux Oleï qui se jette dans le fleuve Amour, avec « l’éternité hivernale » (p. 30) qui recouvrait les isbas de neige, les beaux printemps où la rivière sortait de son lit, et « le soleil déversait l’odeur chaude de la résine de cèdre » (p. 30).
 Un jour Outkine trouve une Kharg-racine, comment a-t-il fait, cette plante étant le secret des femmes yakoutes ? Peut-être parce qu’Outkine était estropié, il voyait les choses différemment ? Cette plante semble féminine, « très agréable au toucher […] peau veloutée […] bulbe aux contours sensuels […] mystérieux intérieur […] liquide rouge comme le sang » (p. 31), « beauté inattendue et déroutante » (p. 32).
Un jour Outkine trouve une Kharg-racine, comment a-t-il fait, cette plante étant le secret des femmes yakoutes ? Peut-être parce qu’Outkine était estropié, il voyait les choses différemment ? Cette plante semble féminine, « très agréable au toucher […] peau veloutée […] bulbe aux contours sensuels […] mystérieux intérieur […] liquide rouge comme le sang » (p. 31), « beauté inattendue et déroutante » (p. 32).
Juan et Outkine ont un autre ami, Samouraï, un peu plus âgé. « Outkine nous regarda tous des deux avec un visage crispé et s’écria d’une voix fêlée : – Mon oncle a raison quand il dit que l’homme est l’animal le pus cruel sur cette terre ! » (p. 55).

Il y a de la sensualité dans ce roman, un « vertige enivrant » (p. 64), la langueur de la nature, les corps nus (sauna brûlant, neige glacée…), la beauté (réelle ou imaginée) des corps féminins, le désir d’amour, les odeurs… Mais qu’est-ce que la vie, l’amour, la mort pour des ados de 14 et 16 ans ?
Le récit commence en février mais de quelle année ? On sait que c’est à l’époque de Brejnev car il est en couverture des journaux (il y a aussi des cosmonautes). Les trois jeunes hommes vont à Nerloug (la plus grande ville de cette région de Sibérie) pour voir au cinéma L’Octobre rouge un film avec Belmondo, Le Magnifique (sorti en France en 1973) et le parti fête ses 70 ans : l’Union soviétique a été proclamée le 30 décembre 1922 et le Parti communiste de l’Union soviétique en 1925 donc l’année où se déroule Au temps du fleuve Amour est sûrement 1975. Quoique… ça parle du 103e anniversaire de Lénine (p. 159) et il est né le 10 avril 1870, une incohérence ?
 « – C’est ça, l’Occident ! Oui, l’Occident était né dans le pétillement du champagne de Crimée, au milieu d’une grande isba noyée dans la neige, après un film français vieux de plusieurs années. C’était l’Occident le plus vrai, car engendré in vitro, oui, dans ce verre à facettes lavé de flots entiers de vodka. Et aussi dans notre imagination vierge. Dans la pureté cristalline de l’air de la taïga. L’Occident était là. […] Nos premiers pas en Occident. » (p. 113). Ce film, ils vont le revoir 17 fois, histoire de s’en imprégner et surtout de tout comprendre parce que des choses occidentales leur échappent bien sûr ! Cette deuxième partie est, en tout cas, une belle déclaration d’amour à Jean-Paul Belmondo !
« – C’est ça, l’Occident ! Oui, l’Occident était né dans le pétillement du champagne de Crimée, au milieu d’une grande isba noyée dans la neige, après un film français vieux de plusieurs années. C’était l’Occident le plus vrai, car engendré in vitro, oui, dans ce verre à facettes lavé de flots entiers de vodka. Et aussi dans notre imagination vierge. Dans la pureté cristalline de l’air de la taïga. L’Occident était là. […] Nos premiers pas en Occident. » (p. 113). Ce film, ils vont le revoir 17 fois, histoire de s’en imprégner et surtout de tout comprendre parce que des choses occidentales leur échappent bien sûr ! Cette deuxième partie est, en tout cas, une belle déclaration d’amour à Jean-Paul Belmondo !
 Avec ses quatre parties différentes et complémentaires (la taïga et le rude hiver, la découverte de l’Occident avec les films de Belmondo et le voyage en train en Extrême-Orient, l’histoire d’Olga et le départ, et New York, les 3e et 4e parties étant bien plus courtes), Au temps du fleuve Amour est un roman d’apprentissage riche, voluptueux, avec une intense âme russe. L’insouciance de l’adolescence, l’immensité et la rudesse de la taïga, la blancheur de la neige – et de tout ce qu’ils ont à découvrir – apportent aux trois jeunes une envie inéluctable d’autre chose, d’aventure, d’ailleurs. Les descriptions des personnages et des paysages sont une grande réussite. Il y a du romantisme, de la nostalgie, un roman typiquement russe bien qu’Andreï Makine soit naturalisé français et écrive en français. D’ailleurs Andreï Makine a-t-il mis un peu de lui, un peu de ses souvenirs et de sa jeunesse dans Dimitri, peut-être même dans un peu de chacun des trois jeunes qui rêvent d’amour et d’Occident ?
Avec ses quatre parties différentes et complémentaires (la taïga et le rude hiver, la découverte de l’Occident avec les films de Belmondo et le voyage en train en Extrême-Orient, l’histoire d’Olga et le départ, et New York, les 3e et 4e parties étant bien plus courtes), Au temps du fleuve Amour est un roman d’apprentissage riche, voluptueux, avec une intense âme russe. L’insouciance de l’adolescence, l’immensité et la rudesse de la taïga, la blancheur de la neige – et de tout ce qu’ils ont à découvrir – apportent aux trois jeunes une envie inéluctable d’autre chose, d’aventure, d’ailleurs. Les descriptions des personnages et des paysages sont une grande réussite. Il y a du romantisme, de la nostalgie, un roman typiquement russe bien qu’Andreï Makine soit naturalisé français et écrive en français. D’ailleurs Andreï Makine a-t-il mis un peu de lui, un peu de ses souvenirs et de sa jeunesse dans Dimitri, peut-être même dans un peu de chacun des trois jeunes qui rêvent d’amour et d’Occident ?
Pour le Challenge lecture 2024 (catégorie 45, un livre d’un auteur russe), Lire en thème 2024 (catégorie Hiver), Petit Bac 2024 (catégorie Lieu pour Fleuve Amour), Tour du monde en 80 livres 2024 (Russie) et Un genre par mois (en janvier, littérature contemporaine).
 Taiki Inomata est en 3e année de collège et il est membre du club de badminton. C’est lui le narrateur. « Chaque matin… je me lève… avec l’espoir d’apercevoir… ». Apercevoir qui ? Chinatsu Kano, 1ère année de lycée, membre du club de basket-ball et déjà championne. Non seulement Taiki va plus qu’apercevoir Chinatsu mais il va se prendre le ballon de basket en pleine tête !
Taiki Inomata est en 3e année de collège et il est membre du club de badminton. C’est lui le narrateur. « Chaque matin… je me lève… avec l’espoir d’apercevoir… ». Apercevoir qui ? Chinatsu Kano, 1ère année de lycée, membre du club de basket-ball et déjà championne. Non seulement Taiki va plus qu’apercevoir Chinatsu mais il va se prendre le ballon de basket en pleine tête !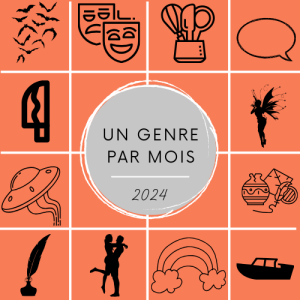 Bref, c’est un shônen romance sportif avec des adolescent(e)s et de l’humour, classique mais agréable car les dessins sont beaux. Le 6e tome va paraître en France mais la série en est à 15 tomes au Japon et encore en cours.
Bref, c’est un shônen romance sportif avec des adolescent(e)s et de l’humour, classique mais agréable car les dessins sont beaux. Le 6e tome va paraître en France mais la série en est à 15 tomes au Japon et encore en cours.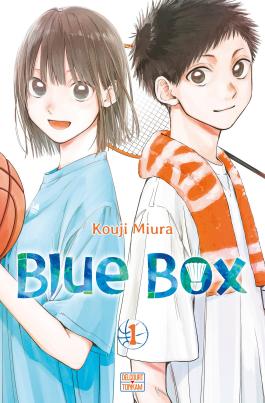

 « […] pourquoi l’un de nous avait-il été propulsé sous des blocs de glace, dans la débâcle effrénée d’un grand fleuve qui avait broyé son corps, le rejetant irrémédiablement mutilé ? Tandis que l’autre, moi… Oui, je murmurais le nom de ce fleuve – Amour – en plongeant dans sa sonorité fraîche comme dans un corps féminin rêvé, conçu d’une même matière souple, douce et brumeuse. » (p. 16).
« […] pourquoi l’un de nous avait-il été propulsé sous des blocs de glace, dans la débâcle effrénée d’un grand fleuve qui avait broyé son corps, le rejetant irrémédiablement mutilé ? Tandis que l’autre, moi… Oui, je murmurais le nom de ce fleuve – Amour – en plongeant dans sa sonorité fraîche comme dans un corps féminin rêvé, conçu d’une même matière souple, douce et brumeuse. » (p. 16). Un jour Outkine trouve une Kharg-racine, comment a-t-il fait, cette plante étant le secret des femmes yakoutes ? Peut-être parce qu’Outkine était estropié, il voyait les choses différemment ? Cette plante semble féminine, « très agréable au toucher […] peau veloutée […] bulbe aux contours sensuels […] mystérieux intérieur […] liquide rouge comme le sang » (p. 31), « beauté inattendue et déroutante » (p. 32).
Un jour Outkine trouve une Kharg-racine, comment a-t-il fait, cette plante étant le secret des femmes yakoutes ? Peut-être parce qu’Outkine était estropié, il voyait les choses différemment ? Cette plante semble féminine, « très agréable au toucher […] peau veloutée […] bulbe aux contours sensuels […] mystérieux intérieur […] liquide rouge comme le sang » (p. 31), « beauté inattendue et déroutante » (p. 32).
 « – C’est ça, l’Occident ! Oui, l’Occident était né dans le pétillement du champagne de Crimée, au milieu d’une grande isba noyée dans la neige, après un film français vieux de plusieurs années. C’était l’Occident le plus vrai, car engendré in vitro, oui, dans ce verre à facettes lavé de flots entiers de vodka. Et aussi dans notre imagination vierge. Dans la pureté cristalline de l’air de la taïga. L’Occident était là. […] Nos premiers pas en Occident. » (p. 113). Ce film, ils vont le revoir 17 fois, histoire de s’en imprégner et surtout de tout comprendre parce que des choses occidentales leur échappent bien sûr ! Cette deuxième partie est, en tout cas, une belle déclaration d’amour à Jean-Paul Belmondo !
« – C’est ça, l’Occident ! Oui, l’Occident était né dans le pétillement du champagne de Crimée, au milieu d’une grande isba noyée dans la neige, après un film français vieux de plusieurs années. C’était l’Occident le plus vrai, car engendré in vitro, oui, dans ce verre à facettes lavé de flots entiers de vodka. Et aussi dans notre imagination vierge. Dans la pureté cristalline de l’air de la taïga. L’Occident était là. […] Nos premiers pas en Occident. » (p. 113). Ce film, ils vont le revoir 17 fois, histoire de s’en imprégner et surtout de tout comprendre parce que des choses occidentales leur échappent bien sûr ! Cette deuxième partie est, en tout cas, une belle déclaration d’amour à Jean-Paul Belmondo ! Avec ses quatre parties différentes et complémentaires (la taïga et le rude hiver, la découverte de l’Occident avec les films de Belmondo et le voyage en train en Extrême-Orient, l’histoire d’Olga et le départ, et New York, les 3e et 4e parties étant bien plus courtes), Au temps du fleuve Amour est un roman d’apprentissage riche, voluptueux, avec une intense âme russe. L’insouciance de l’adolescence, l’immensité et la rudesse de la taïga, la blancheur de la neige – et de tout ce qu’ils ont à découvrir – apportent aux trois jeunes une envie inéluctable d’autre chose, d’aventure, d’ailleurs. Les descriptions des personnages et des paysages sont une grande réussite. Il y a du romantisme, de la nostalgie, un roman typiquement russe bien qu’Andreï Makine soit naturalisé français et écrive en français. D’ailleurs Andreï Makine a-t-il mis un peu de lui, un peu de ses souvenirs et de sa jeunesse dans Dimitri, peut-être même dans un peu de chacun des trois jeunes qui rêvent d’amour et d’Occident ?
Avec ses quatre parties différentes et complémentaires (la taïga et le rude hiver, la découverte de l’Occident avec les films de Belmondo et le voyage en train en Extrême-Orient, l’histoire d’Olga et le départ, et New York, les 3e et 4e parties étant bien plus courtes), Au temps du fleuve Amour est un roman d’apprentissage riche, voluptueux, avec une intense âme russe. L’insouciance de l’adolescence, l’immensité et la rudesse de la taïga, la blancheur de la neige – et de tout ce qu’ils ont à découvrir – apportent aux trois jeunes une envie inéluctable d’autre chose, d’aventure, d’ailleurs. Les descriptions des personnages et des paysages sont une grande réussite. Il y a du romantisme, de la nostalgie, un roman typiquement russe bien qu’Andreï Makine soit naturalisé français et écrive en français. D’ailleurs Andreï Makine a-t-il mis un peu de lui, un peu de ses souvenirs et de sa jeunesse dans Dimitri, peut-être même dans un peu de chacun des trois jeunes qui rêvent d’amour et d’Occident ?
 « mère / Mon poussin, ma toute petite, moi qui t’ai formée au rythme des secrets de mon ventre, je t’ai vue finalement grandir. En dépit de tout. De toutes ces choses incompréhensibles et qui t’étaient contraires.
« mère / Mon poussin, ma toute petite, moi qui t’ai formée au rythme des secrets de mon ventre, je t’ai vue finalement grandir. En dépit de tout. De toutes ces choses incompréhensibles et qui t’étaient contraires. Isor, 13 ans (au début du roman), est différente depuis sa naissance, elle est mutique mais, lorsqu’elle rencontre le voisin septuagénaire, Lucien, c’est comme si ces deux âmes esseulées se retrouvaient.
Isor, 13 ans (au début du roman), est différente depuis sa naissance, elle est mutique mais, lorsqu’elle rencontre le voisin septuagénaire, Lucien, c’est comme si ces deux âmes esseulées se retrouvaient. C’est pour cette raison que j’ai voulu regarder le film documentaire, Dernières nouvelles du cosmos, réalisé en 2016 par Julie Bertuccelli dont un collègue a parlé. La réalisatrice filme Hélène (née en 1985) et sa maman, Véronique, au quotidien. Et quelle claque aussi ! Un univers totalement différent, un monde énorme, surprenant, cosmique ! Hélène est autiste, elle aime la musique, la nature (avec lesquelles elle est comme en connexion) et elle est poétesse sous le pseudonyme de Babouillec Sp (pour Sans paroles) même si elle arrive à prononcer quelques mots mais le travail est constant. Trois belles personnes, Julie, Véronique et Hélène, et les membres de la troupe (en particulier Pierre Meunier et Marguerite Bordat) qui ont monté le spectacle Forbidden di sporgersi avec les textes de Babouillec, spectacle présenté à Paris et à Avignon, entre autres (infos sur
C’est pour cette raison que j’ai voulu regarder le film documentaire, Dernières nouvelles du cosmos, réalisé en 2016 par Julie Bertuccelli dont un collègue a parlé. La réalisatrice filme Hélène (née en 1985) et sa maman, Véronique, au quotidien. Et quelle claque aussi ! Un univers totalement différent, un monde énorme, surprenant, cosmique ! Hélène est autiste, elle aime la musique, la nature (avec lesquelles elle est comme en connexion) et elle est poétesse sous le pseudonyme de Babouillec Sp (pour Sans paroles) même si elle arrive à prononcer quelques mots mais le travail est constant. Trois belles personnes, Julie, Véronique et Hélène, et les membres de la troupe (en particulier Pierre Meunier et Marguerite Bordat) qui ont monté le spectacle Forbidden di sporgersi avec les textes de Babouillec, spectacle présenté à Paris et à Avignon, entre autres (infos sur 



 Une histoire prenante avec des sujets importants (mal-être de l’adolescence, différences, harcèlement scolaire…) et une pointe de fantastique. Mademoiselle Loup m’intrigue !
Une histoire prenante avec des sujets importants (mal-être de l’adolescence, différences, harcèlement scolaire…) et une pointe de fantastique. Mademoiselle Loup m’intrigue !
 Comme c’est l’anniversaire de Fûka, Kokoro aimerait lui offrir un cadeau mais pour cela, elle va devoir sortir, marcher dans la rue, aller dans un magasin et elle a très peur de croiser d’autres collégiens… « Non ! Je n’ai pas fait tout ce chemin pour rien ! ».
Comme c’est l’anniversaire de Fûka, Kokoro aimerait lui offrir un cadeau mais pour cela, elle va devoir sortir, marcher dans la rue, aller dans un magasin et elle a très peur de croiser d’autres collégiens… « Non ! Je n’ai pas fait tout ce chemin pour rien ! ». Il y a de bons moments au château, parfois des disputes, mais chacun s’ouvre un peu. Cependant mademoiselle Loup essaie-t-elle de semer la zizanie avec ses nouvelles informations sur la clé ?
Il y a de bons moments au château, parfois des disputes, mais chacun s’ouvre un peu. Cependant mademoiselle Loup essaie-t-elle de semer la zizanie avec ses nouvelles informations sur la clé ?

 Beyrouth, Collège Notre-Dame de l’Annonciation. Elles sont en 5e. Soumaya et Ingrid portent l’uniforme du collège mais elles savent mettre en valeur leurs seins, leurs fesses et leurs genoux aussi. Elles sont surnommées les Dangereuses, elles sont considérées comme déviantes, parfois punies mais elles s’en fichent.
Beyrouth, Collège Notre-Dame de l’Annonciation. Elles sont en 5e. Soumaya et Ingrid portent l’uniforme du collège mais elles savent mettre en valeur leurs seins, leurs fesses et leurs genoux aussi. Elles sont surnommées les Dangereuses, elles sont considérées comme déviantes, parfois punies mais elles s’en fichent. Je suis surprise par l’obsession qui en résulte ! J’ai évidemment moi aussi vécu « les tumultes de l’adolescence » (p. 113) mais de façon plus naturelle, plus libre, et à une époque où l’informatique n’était pas démocratisée, où internet et les téléphones portables n’existaient pas. Quelle tristesse de ne vivre que « juste la mécanique » (p. 116)… Mais, peut-être que j’ai bénéficié d’un « accès serein aux grands rites de l’adolescence occidentale » (p. 119) ?
Je suis surprise par l’obsession qui en résulte ! J’ai évidemment moi aussi vécu « les tumultes de l’adolescence » (p. 113) mais de façon plus naturelle, plus libre, et à une époque où l’informatique n’était pas démocratisée, où internet et les téléphones portables n’existaient pas. Quelle tristesse de ne vivre que « juste la mécanique » (p. 116)… Mais, peut-être que j’ai bénéficié d’un « accès serein aux grands rites de l’adolescence occidentale » (p. 119) ?
 Hervé Commereau et Romuald (Romu) Perrier sont deux ados qui vivent dans une petite ville. Ils s’ennuient et font les 400 coups. Surtout Hervé qui commence à s’intéresser aux filles et qui redouble pour la 3e fois. Romu n’ose pas lui dire qu’il passe en seconde pour ne pas lui gâcher ses vacances d’été. Lui est passionné par les trains (il connaît tous les horaires par cœur) et veut en faire son métier. Ils sont amis avec Mathilde Domenier, une jeune femme, grosse mais bien dans sa peau, caissière à l’hyper-marché. Arrive une nouvelle voisine, Lucie, grande, mince (plutôt taille 34)..
Hervé Commereau et Romuald (Romu) Perrier sont deux ados qui vivent dans une petite ville. Ils s’ennuient et font les 400 coups. Surtout Hervé qui commence à s’intéresser aux filles et qui redouble pour la 3e fois. Romu n’ose pas lui dire qu’il passe en seconde pour ne pas lui gâcher ses vacances d’été. Lui est passionné par les trains (il connaît tous les horaires par cœur) et veut en faire son métier. Ils sont amis avec Mathilde Domenier, une jeune femme, grosse mais bien dans sa peau, caissière à l’hyper-marché. Arrive une nouvelle voisine, Lucie, grande, mince (plutôt taille 34).. Cette bande dessinée est une parfaite collaboration entre le scénariste et le dessinateur ; elle est réussie tant au niveau du scénario que du dessin qui accompagne vraiment bien. Les quatre personnages principaux (ils sont sur la couverture) sont agréablement servi par le dessin et leurs caractéristiques. Il y a parfois de l’humour mais c’est plutôt une histoire douce-amère sur l’adolescence, la vie et l’ennui. Mais l’histoire se transforme en drame !
Cette bande dessinée est une parfaite collaboration entre le scénariste et le dessinateur ; elle est réussie tant au niveau du scénario que du dessin qui accompagne vraiment bien. Les quatre personnages principaux (ils sont sur la couverture) sont agréablement servi par le dessin et leurs caractéristiques. Il y a parfois de l’humour mais c’est plutôt une histoire douce-amère sur l’adolescence, la vie et l’ennui. Mais l’histoire se transforme en drame !
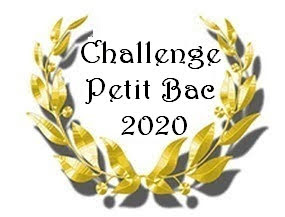 Pas sûre que je lise son premier roman Nobody (même s’il se déroule à Tchernobyl) ou son nouveau roman, 8 kilomètres, paru en janvier 2020…
Pas sûre que je lise son premier roman Nobody (même s’il se déroule à Tchernobyl) ou son nouveau roman, 8 kilomètres, paru en janvier 2020…