 Journal ou Mémoires de la vie littéraire des frères Goncourt.
Journal ou Mémoires de la vie littéraire des frères Goncourt.
Rédigé de 1851 à 1895 mais n’est publié qu’en 1887. Publication en 3 tomes chez Bouquins.
Genres : littérature française, journal intime, classique.
L’aîné, Edmond Louis Antoine Huot de Goncourt naît le 26 mai 1822 à Nancy dans la Meurthe. Il meurt le 16 juillet 1896 à Draveil en Seine et Oise (d’une embolie pulmonaire fulgurante) et, durant l’inhumation à laquelle assistent les hommes politiques de l’époque (Clemenceau, Poincaré, entre autres) Émile Zola fait une oraison funèbre. Le cadet, Jules Huot de Goncourt naît le 17 décembre 1830 à Paris. Il meurt le 20 juin 1870 à Paris (d’une paralysie due à la syphilis). Les deux frères sont enterrés au cimetière de Montmartre.
Jules commence le Journal et après sa mort, Edmond le continue. Les deux frères publient ensemble Histoire de la société française pendant la Révolution (1854), Portraits intimes du XVIIIe siècle (1857), Histoire de Marie-Antoinette (1858), L’art du XVIIIe siècle (1859-1870), Charles Demailly (1860), Sœur Philomène (1861), Renée Mauperin (1864), Germinie Lacerteux (1865), Idées et sensations (1866), Manette Salomon (1867), Madame Gervaisais (1869), puis Edmond publie seul La fille Élisa (1877), La Du Barry (1878), La duchesse de Châteauroux et ses sœurs (1879), Les frères Zemganno (1879), La maison d’un artiste (1881), La Saint-Hubert (d’après sa correspondance et ses papiers de famille, 1882), Chérie (1884), La femme au XVIIIe siècle (1887) et Madame de Pompadour (1888), des œuvres appartenant au courant du naturalisme (et, remarquez, beaucoup d’histoires de femmes).

Edmond et Jules de Goncourt photographiés par Nadar
Les deux frères étudient au lycée Condorcet et ont de nombreux amis écrivains ou artistes (Théodore de Banville, Maurice Barrès, Alphonse et Léon Daudet, Gustave Flaubert, Paul Gavarni, Gustave Geffroy, Roger Marx, Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, Auguste Rodin, Ivan Tourgueniev, Émile Zola, entre autres, source Wikipédia). Le dimanche, ils animent un salon littéraire Le Grenier. Ils sont célèbres pour la création du Prix Goncourt mais celui-ci est créé par le testament d’Edmond de Goncourt en 1892. Ainsi la Société littéraire des Goncourt, dite Académie Goncourt, est officiellement fondée en 1902 et le premier prix Goncourt est proclamé le 21 décembre 1903.
Le Journal que j’ai lu en numérique commence en décembre 1851.

2 décembre 1851. Rue Saint-Georges, tôt le matin. « Mais qu’est-ce qu’un coup d’État, qu’est-ce qu’un changement de gouvernement pour des gens qui, le même jour, doivent publier leur premier roman. Or, par une malechance ironique, c’était notre cas. » Quelle malchance, effectivement ! « Votre roman… un roman… la France se fiche pas mal des romans aujourd’hui, mes gaillards ! » (leur cousin Blamont). Comble de malchance, « Et dans la rue, de suite nos yeux aux affiches, car égoïstement nous l’avouons, — parmi tout ce papier fraîchement placardé, annonçant la nouvelle troupe, son répertoire, ses exercices, les chefs d’emploi, et la nouvelle adresse du directeur passé de l’Élysée aux Tuileries — nous cherchions la nôtre d’affiche, l’affiche qui devait annoncer à Paris la publication d’En 18, et apprendre à la France et au monde les noms de deux hommes de lettres de plus : Edmond et Jules de Goncourt. L’affiche manquait aux murs. » Gloups !
15 décembre 1851. « — Jules, Jules… un article de Janin dans les Débats ! C’est Edmond qui, de son lit, me crie la bonne et inattendue nouvelle. Oui, tout un feuilleton du lundi parlant de nous à propos de tout et de tout à propos de nous, et pendant douze colonnes, battant et brouillant le compte rendu de notre livre avec le compte rendu de la Dinde truffée, de M. Varin, et des Crapauds immortels, de MM. Clairville et Dumanoir : un feuilleton où Janin nous fouettait avec de l’ironie, nous pardonnait avec de l’estime et de la critique sérieuse ; un feuilleton présentant au public notre jeunesse avec un serrement de main et l’excuse bienveillante de ses témérités. » Ah, voici le début de la célébrité ! Même si ce n’est pas l’idéal…
21 décembre 1851. Après une visite à Janin, les frères Goncourt sont introduits chez madame Allan, une actrice qui vit rue Mogador. Et puis la course folle pour rencontrer le « directeur du Théâtre-Français, auquel nous sommes parfaitement inconnus », aller chez Lireux, chez Brindeau, puis de nouveau au Théâtre-Français, tout ça pour être lus et joués au théâtre.
 23 décembre 1851. « Ce n’est pas gentil, ça ! »
23 décembre 1851. « Ce n’est pas gentil, ça ! »
Fin janvier 1852. « L’Éclair, Revue hebdomadaire de la Littérature, des Théâtres et des Arts, a paru le 12 janvier. », leur journal, enfin ! Mais, dans les locaux du journal, ils passent leur temps « à attendre l’abonnement, le public, les collaborateurs. Rien ne vient. Pas même de copie, fait inconcevable ! Pas même un poète, fait plus miraculeux encore ! » Zut, leur carrière démarre bien mal… « Nous continuons intrépidement notre journal dans le vide, avec une foi d’apôtres et des illusions d’actionnaires. » mais, évidemment, l’argent vient à manquer. Pourtant Nadar commence à y publier des caricatures.
Août 1852. Victor Hugo, en exil, envoie une lettre à Janin.
22 octobre 1852. « Le Paris paraît aujourd’hui. C’est, croyons-nous, le premier journal littéraire quotidien, depuis la fondation du monde. Nous écrivons l’article d’en-tête. »
Janvier 1853. « Les bureaux du Paris, d’abord établis, 1 rue Laffitte, à la Maison d’Or, furent, au bout de quelques mois, transférés rue Bergère, au-dessus de l’Assemblée Nationale. » et plus loin, « À l’heure présente, le journal remue, il ne fait pas d’argent, mais il fait du bruit. Il est jeune, indépendant, ayant comme l’héritage des convictions littéraires de 1830. C’est dans ses colonnes l’ardeur et le beau feu d’une nuée de tirailleurs marchant sans ordre ni discipline, mais tous pleins de mépris pour l’abonnement et l’abonné. Oui, oui, il y a là de la fougue, de l’audace, de l’imprudence, enfin du dévouement à un certain idéal mêlé d’un peu de folie, d’un peu de ridicule… un journal, en un mot, dont la singularité, l’honneur, est de n’être point une affaire. »
 20 février 1853. « Un jour de la fin du mois de décembre dernier, Villedeuil rentrait du ministère en disant avec une voix de cinquième acte : — Le journal est poursuivi. Il y a deux articles incriminés. L’un est de Karr ; l’autre, c’est un article où il y a des vers… Qui est-ce qui a mis des vers dans un article, ce mois-ci ? — C’est nous ! disions-nous. — Eh bien ! c’est vous qui êtes poursuivis avec Karr. » Pas facile, la vie d’auteurs, poètes, dramaturges, critiques littéraires… Voici un extrait des vers incriminés : « Croisant ses beaux membres nus / Sur son Adonis qu’elle baise ; / Et lui pressant le doux flanc ; / Son cou douillettement blanc, /Mordille de trop grande aise. » Je rappelle que « baiser » signifiait à l’époque « embrasser ». « Il nous fallait un avocat », c’est sûr ! Heureusement avec un bon avocat : « En ce qui touche l’article signé Edmond et Jules de Goncourt, dans le numéro du journal Paris, du 11 décembre 1853. Attendu que si les passages incriminés de l’article présentent à l’esprit des lecteurs des images évidemment licencieuses et dès lors blâmables, il résulte cependant de l’ensemble de l’article que les auteurs de la publication dont il s’agit n’ont pas eu l’intention d’outrager la morale publique et les bonnes mœurs. Par ces motifs : Renvoie Alphonse Karr, Edmond et Jules de Goncourt et Lebarbier (le gérant du journal) des fins de la plainte, sans dépens. Nous étions acquittés, mais blâmés. »
20 février 1853. « Un jour de la fin du mois de décembre dernier, Villedeuil rentrait du ministère en disant avec une voix de cinquième acte : — Le journal est poursuivi. Il y a deux articles incriminés. L’un est de Karr ; l’autre, c’est un article où il y a des vers… Qui est-ce qui a mis des vers dans un article, ce mois-ci ? — C’est nous ! disions-nous. — Eh bien ! c’est vous qui êtes poursuivis avec Karr. » Pas facile, la vie d’auteurs, poètes, dramaturges, critiques littéraires… Voici un extrait des vers incriminés : « Croisant ses beaux membres nus / Sur son Adonis qu’elle baise ; / Et lui pressant le doux flanc ; / Son cou douillettement blanc, /Mordille de trop grande aise. » Je rappelle que « baiser » signifiait à l’époque « embrasser ». « Il nous fallait un avocat », c’est sûr ! Heureusement avec un bon avocat : « En ce qui touche l’article signé Edmond et Jules de Goncourt, dans le numéro du journal Paris, du 11 décembre 1853. Attendu que si les passages incriminés de l’article présentent à l’esprit des lecteurs des images évidemment licencieuses et dès lors blâmables, il résulte cependant de l’ensemble de l’article que les auteurs de la publication dont il s’agit n’ont pas eu l’intention d’outrager la morale publique et les bonnes mœurs. Par ces motifs : Renvoie Alphonse Karr, Edmond et Jules de Goncourt et Lebarbier (le gérant du journal) des fins de la plainte, sans dépens. Nous étions acquittés, mais blâmés. »
27 juillet 1853. « Je vais voir Rouland pour savoir si je puis publier la Lorette sans retourner en police correctionnelle. » Enfin, « La Lorette paraît. Elle est épuisée en une semaine. C’est pour nous la révélation qu’on peut vendre un livre. »
Septembre 1853. Les deux frères accompagnent des amis à la mer, « à Veules, une pittoresque avalure de falaise, tout nouvellement découverte par les artistes. » Ils y rencontrent donc de jeunes artistes. « Veules est un coin de terre charmant, et l’on y serait admirablement s’il n’y avait pas qu’une seule auberge, et, dans cette auberge, un aubergiste ayant inventé des plats de viande composés uniquement de gésiers et de pattes de canards… Nous passons là un mois, dans la mer, la verdure, la famine, les controverses grammaticales, et nous revenons un peu refroidis avec l’humanitaire Leroy, au sujet de l’homicide d’un petit crabe, écrasé par moi sur la plage. »
 Ensuite le Journal passe à l’année 1854 et continue jusqu’en 1895 (neuvième volume !) mais je n’ai pas le temps de tout lire. Par contre, ça me plaît beaucoup alors je sais que je le reprendrai de temps en temps. Ce Journal raconte le quotidien des deux frères qui n’ont pratiquement jamais été séparés, leurs relations amicales (écrivains, artistes…) mais aussi leurs rapports avec la critique (pas toujours tendre avec eux mais c’était le cas avec d’autres auteurs contemporains, par exemple Hugo et Zola en ont fait les frais), leurs virées (salons, repas mondains, promenades…), leur difficulté d’être publiés (leurs romans sont souvent adaptés au théâtre, c’était de mise à cette époque mais comment savoir si le succès serait au rendez-vous) et de tenir leur revue (littéraire et artistique) à flot, leurs démêlés avec la justice et la censure sous la Troisième République et sous le Second Empire, quelques opinions politiques (en particulier l’antisémitisme d’Edmond ami avec Édouard Drumont), des propos et indiscrétions sur les personnalités de l’époque (littéraires, artistiques, politiques…), tout ceci est donc passionnant tant au niveau historique que littéraire et souvent amusant.
Ensuite le Journal passe à l’année 1854 et continue jusqu’en 1895 (neuvième volume !) mais je n’ai pas le temps de tout lire. Par contre, ça me plaît beaucoup alors je sais que je le reprendrai de temps en temps. Ce Journal raconte le quotidien des deux frères qui n’ont pratiquement jamais été séparés, leurs relations amicales (écrivains, artistes…) mais aussi leurs rapports avec la critique (pas toujours tendre avec eux mais c’était le cas avec d’autres auteurs contemporains, par exemple Hugo et Zola en ont fait les frais), leurs virées (salons, repas mondains, promenades…), leur difficulté d’être publiés (leurs romans sont souvent adaptés au théâtre, c’était de mise à cette époque mais comment savoir si le succès serait au rendez-vous) et de tenir leur revue (littéraire et artistique) à flot, leurs démêlés avec la justice et la censure sous la Troisième République et sous le Second Empire, quelques opinions politiques (en particulier l’antisémitisme d’Edmond ami avec Édouard Drumont), des propos et indiscrétions sur les personnalités de l’époque (littéraires, artistiques, politiques…), tout ceci est donc passionnant tant au niveau historique que littéraire et souvent amusant.
J’ai effectué cette lecture pour Les classiques c’est fantastique, le thème de février étant ‘Les couples littéraires’ (je n’ai pas pris ça obligatoirement comme un homme et une femme). Elle entre aussi dans 2023 sera classique, ABC illimité (lettre J pour titre) et Challenge lecture 2023 (catégorie 23, un livre écrit à 4 mains, 2e billet).
 Le challenge de lectures de classiques revient cette année : 2024 sera classique aussi ! avec Nathalie aux manettes.
Le challenge de lectures de classiques revient cette année : 2024 sera classique aussi ! avec Nathalie aux manettes.



 23 décembre 1851. « Ce n’est pas gentil, ça ! »
23 décembre 1851. « Ce n’est pas gentil, ça ! » 20 février 1853. « Un jour de la fin du mois de décembre dernier, Villedeuil rentrait du ministère en disant avec une voix de cinquième acte : — Le journal est poursuivi. Il y a deux articles incriminés. L’un est de Karr ; l’autre, c’est un article où il y a des vers… Qui est-ce qui a mis des vers dans un article, ce mois-ci ? — C’est nous ! disions-nous. — Eh bien ! c’est vous qui êtes poursuivis avec Karr. » Pas facile, la vie d’auteurs, poètes, dramaturges, critiques littéraires… Voici un extrait des vers incriminés : « Croisant ses beaux membres nus / Sur son Adonis qu’elle baise ; / Et lui pressant le doux flanc ; / Son cou douillettement blanc, /Mordille de trop grande aise. » Je rappelle que « baiser » signifiait à l’époque « embrasser ». « Il nous fallait un avocat », c’est sûr ! Heureusement avec un bon avocat : « En ce qui touche l’article signé Edmond et Jules de Goncourt, dans le numéro du journal Paris, du 11 décembre 1853. Attendu que si les passages incriminés de l’article présentent à l’esprit des lecteurs des images évidemment licencieuses et dès lors blâmables, il résulte cependant de l’ensemble de l’article que les auteurs de la publication dont il s’agit n’ont pas eu l’intention d’outrager la morale publique et les bonnes mœurs. Par ces motifs : Renvoie Alphonse Karr, Edmond et Jules de Goncourt et Lebarbier (le gérant du journal) des fins de la plainte, sans dépens. Nous étions acquittés, mais blâmés. »
20 février 1853. « Un jour de la fin du mois de décembre dernier, Villedeuil rentrait du ministère en disant avec une voix de cinquième acte : — Le journal est poursuivi. Il y a deux articles incriminés. L’un est de Karr ; l’autre, c’est un article où il y a des vers… Qui est-ce qui a mis des vers dans un article, ce mois-ci ? — C’est nous ! disions-nous. — Eh bien ! c’est vous qui êtes poursuivis avec Karr. » Pas facile, la vie d’auteurs, poètes, dramaturges, critiques littéraires… Voici un extrait des vers incriminés : « Croisant ses beaux membres nus / Sur son Adonis qu’elle baise ; / Et lui pressant le doux flanc ; / Son cou douillettement blanc, /Mordille de trop grande aise. » Je rappelle que « baiser » signifiait à l’époque « embrasser ». « Il nous fallait un avocat », c’est sûr ! Heureusement avec un bon avocat : « En ce qui touche l’article signé Edmond et Jules de Goncourt, dans le numéro du journal Paris, du 11 décembre 1853. Attendu que si les passages incriminés de l’article présentent à l’esprit des lecteurs des images évidemment licencieuses et dès lors blâmables, il résulte cependant de l’ensemble de l’article que les auteurs de la publication dont il s’agit n’ont pas eu l’intention d’outrager la morale publique et les bonnes mœurs. Par ces motifs : Renvoie Alphonse Karr, Edmond et Jules de Goncourt et Lebarbier (le gérant du journal) des fins de la plainte, sans dépens. Nous étions acquittés, mais blâmés. » Ensuite le Journal passe à l’année 1854 et continue jusqu’en 1895 (neuvième volume !) mais je n’ai pas le temps de tout lire. Par contre, ça me plaît beaucoup alors je sais que je le reprendrai de temps en temps. Ce Journal raconte le quotidien des deux frères qui n’ont pratiquement jamais été séparés, leurs relations amicales (écrivains, artistes…) mais aussi leurs rapports avec la critique (pas toujours tendre avec eux mais c’était le cas avec d’autres auteurs contemporains, par exemple Hugo et Zola en ont fait les frais), leurs virées (salons, repas mondains, promenades…), leur difficulté d’être publiés (leurs romans sont souvent adaptés au théâtre, c’était de mise à cette époque mais comment savoir si le succès serait au rendez-vous) et de tenir leur revue (littéraire et artistique) à flot, leurs démêlés avec la justice et la censure sous la Troisième République et sous le Second Empire, quelques opinions politiques (en particulier l’antisémitisme d’Edmond ami avec Édouard Drumont), des propos et indiscrétions sur les personnalités de l’époque (littéraires, artistiques, politiques…), tout ceci est donc passionnant tant au niveau historique que littéraire et souvent amusant.
Ensuite le Journal passe à l’année 1854 et continue jusqu’en 1895 (neuvième volume !) mais je n’ai pas le temps de tout lire. Par contre, ça me plaît beaucoup alors je sais que je le reprendrai de temps en temps. Ce Journal raconte le quotidien des deux frères qui n’ont pratiquement jamais été séparés, leurs relations amicales (écrivains, artistes…) mais aussi leurs rapports avec la critique (pas toujours tendre avec eux mais c’était le cas avec d’autres auteurs contemporains, par exemple Hugo et Zola en ont fait les frais), leurs virées (salons, repas mondains, promenades…), leur difficulté d’être publiés (leurs romans sont souvent adaptés au théâtre, c’était de mise à cette époque mais comment savoir si le succès serait au rendez-vous) et de tenir leur revue (littéraire et artistique) à flot, leurs démêlés avec la justice et la censure sous la Troisième République et sous le Second Empire, quelques opinions politiques (en particulier l’antisémitisme d’Edmond ami avec Édouard Drumont), des propos et indiscrétions sur les personnalités de l’époque (littéraires, artistiques, politiques…), tout ceci est donc passionnant tant au niveau historique que littéraire et souvent amusant.
 L’histoire du temple Shuzen – d’après L’histoire du temple Shuzen de Kidô Okamoto (1872-1939), auteur de
L’histoire du temple Shuzen – d’après L’histoire du temple Shuzen de Kidô Okamoto (1872-1939), auteur de 


 1. Condition de nuage (1939-1955) : Le tournesol (4 poèmes), Semences pour un hymne (12 poèmes), Pierres éparses (3 poèmes). Certains poèmes se lisent vite comme ceux de genre haïkus (3 lignes), le premier étant « Le jour ouvre la main / Trois nuages / Et ce peu de paroles. » (p. 23) et il y en a d’autres plus loin. Certains poèmes plus longs se lisent et se relisent : Octavio Paz a des éléments, des inspirations que je ne connais pas mais je comprends à peu près ce qu’il veut dire, l’amour, les jours qui se suivent, les saisons et les éléments ont de l’importance, la parole et la liberté aussi bien sûr.
1. Condition de nuage (1939-1955) : Le tournesol (4 poèmes), Semences pour un hymne (12 poèmes), Pierres éparses (3 poèmes). Certains poèmes se lisent vite comme ceux de genre haïkus (3 lignes), le premier étant « Le jour ouvre la main / Trois nuages / Et ce peu de paroles. » (p. 23) et il y en a d’autres plus loin. Certains poèmes plus longs se lisent et se relisent : Octavio Paz a des éléments, des inspirations que je ne connais pas mais je comprends à peu près ce qu’il veut dire, l’amour, les jours qui se suivent, les saisons et les éléments ont de l’importance, la parole et la liberté aussi bien sûr. 2. Aigle ou soleil ? (1949-1950) : introduction (2 textes), Sables mouvants (4 poèmes), Aigle ou Soleil ? (19 poèmes). Voici comment cette section débute : « Je commence et recommence. Mais je n’avance pas. Chaque fois qu’elle atteint les lettres fatales, la plume recule : un interdit improbable me ferme le chemin. Hier, investi des pleins pouvoirs, j’écrivais sans peine […]. Aujourd’hui, je lutte seul avec une parole. Celle qui m’appartient, celle à laquelle j’appartiens […] » (p. 45). Liberté (aigle) ou manque (perte) de liberté (soleil) ? Culture hispanique (aigle) ou culture indigène (soleil) ? Octavio Paz joue sur les mots et avec les mots. J’ai ressenti un petit côté kafkaïen durant cette nuit d’insomnie par exemple : « Je me relève : il est à peine une heure. Je m’allonge, mes pieds sortent de la chambre, ma tête perfore les murs. Je m’étends dans l’immensité comme les racines d’un arbre sacré, comme la musique, comme la mer. La nuit se peuple de pattes, de dents, de griffes, de ventouses. Comment défendre ce corps trop grand ? Que font, à des kilomètres de distance mes orteils, mes doigts, mes oreilles ? Je me rétrécis lentement. Le lit craque, mon squelette craque, les charnières du monde grincent. […] » (p. 52). Qu’en pensez-vous ? En tout cas, nous avons ici de la poésie libre, en fait en prose, comme autant d’histoires surréalistes qui parlent d’amour, de folie, de nuit, de prison… « On nous dit : un sentier droit ne mène jamais à l’hiver. Maintenant, mes mains tremblent. Les mots me pendent de la bouche. Donne-moi un petit siège et un peu de soleil. » (p. 92). Je comprends que le petit siège correspond à la culture hispanique et le soleil à la culture amérindienne.
2. Aigle ou soleil ? (1949-1950) : introduction (2 textes), Sables mouvants (4 poèmes), Aigle ou Soleil ? (19 poèmes). Voici comment cette section débute : « Je commence et recommence. Mais je n’avance pas. Chaque fois qu’elle atteint les lettres fatales, la plume recule : un interdit improbable me ferme le chemin. Hier, investi des pleins pouvoirs, j’écrivais sans peine […]. Aujourd’hui, je lutte seul avec une parole. Celle qui m’appartient, celle à laquelle j’appartiens […] » (p. 45). Liberté (aigle) ou manque (perte) de liberté (soleil) ? Culture hispanique (aigle) ou culture indigène (soleil) ? Octavio Paz joue sur les mots et avec les mots. J’ai ressenti un petit côté kafkaïen durant cette nuit d’insomnie par exemple : « Je me relève : il est à peine une heure. Je m’allonge, mes pieds sortent de la chambre, ma tête perfore les murs. Je m’étends dans l’immensité comme les racines d’un arbre sacré, comme la musique, comme la mer. La nuit se peuple de pattes, de dents, de griffes, de ventouses. Comment défendre ce corps trop grand ? Que font, à des kilomètres de distance mes orteils, mes doigts, mes oreilles ? Je me rétrécis lentement. Le lit craque, mon squelette craque, les charnières du monde grincent. […] » (p. 52). Qu’en pensez-vous ? En tout cas, nous avons ici de la poésie libre, en fait en prose, comme autant d’histoires surréalistes qui parlent d’amour, de folie, de nuit, de prison… « On nous dit : un sentier droit ne mène jamais à l’hiver. Maintenant, mes mains tremblent. Les mots me pendent de la bouche. Donne-moi un petit siège et un peu de soleil. » (p. 92). Je comprends que le petit siège correspond à la culture hispanique et le soleil à la culture amérindienne.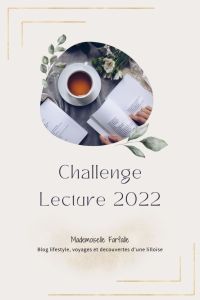 3. À la limite du monde (1937-1958) : introduction (2 poèmes), La saison violente (8 poèmes). Nous retrouvons ici de la poésie plus classique. « Dans la lumière filtrée par les feuilles, / poissons somnambules et absorbés, / passent des hommes, femmes, enfants, bicyclettes. / Ils vont tous, nul ne s’arrête. / Chacun a sa petite affaire : / le cinéma, la messe, le bureau, la mort, / se perdre en d’autres bras, / en d’autres yeux se retrouver, / se souvenir qu’on est un être vivant, l’oublier. / Personne ne veut atteindre la fin, / où la fleur est fruit, le fruit lèvres. » (p. 122). Cette partie est plus sombre, peut-être plus imaginative aussi. « […] voici l’homme qui tombe et se lève et se repaît de poussière et rampe, / l’insecte humain qui troue la pierre, qui troue les siècles et que la lumière carie, / voici la pierre cassée, l’homme cassé, la lumière cassée. » (p. 154). Je pense qu’ici, Paz est désabusé par les violences, le fascisme, les exactions politiques de tous bords…
3. À la limite du monde (1937-1958) : introduction (2 poèmes), La saison violente (8 poèmes). Nous retrouvons ici de la poésie plus classique. « Dans la lumière filtrée par les feuilles, / poissons somnambules et absorbés, / passent des hommes, femmes, enfants, bicyclettes. / Ils vont tous, nul ne s’arrête. / Chacun a sa petite affaire : / le cinéma, la messe, le bureau, la mort, / se perdre en d’autres bras, / en d’autres yeux se retrouver, / se souvenir qu’on est un être vivant, l’oublier. / Personne ne veut atteindre la fin, / où la fleur est fruit, le fruit lèvres. » (p. 122). Cette partie est plus sombre, peut-être plus imaginative aussi. « […] voici l’homme qui tombe et se lève et se repaît de poussière et rampe, / l’insecte humain qui troue la pierre, qui troue les siècles et que la lumière carie, / voici la pierre cassée, l’homme cassé, la lumière cassée. » (p. 154). Je pense qu’ici, Paz est désabusé par les violences, le fascisme, les exactions politiques de tous bords… J’ai lu la préface de Claude Roy après avoir lu le recueil parce que je voulais un œil neuf, un œil ouvert pour cette poésie mexicaine et cet auteur que je lisais pour la première fois, pour m’en imprégner, pour essayer de comprendre par moi-même, mais c’est vrai que cette préface explique des choses sur la vie, les influences (hispaniques et indiennes, révolutions mexicaine et espagnole, ouvertures sur l’Europe, les États-Unis et l’Asie) et l’œuvre d’Octavio Paz, un auteur que je relirai, c’est sûr. Grâce à un grand-père intellectuel indigéniste, à un père avocat qui voyage aux États-Unis, à une tante française qui lui fait découvrir la littérature française, Octavio Paz est, dès l’enfance, ouvert au monde, aux autres, au passé aussi. « Vie vagabonde, entre le Mexique, les États-Unis, la France, le Japon, l’Inde. » (p. 10), il a oublié l’Espagne puisque Paz y est allé durant la révolution (1937). Je comprends mieux les inspirations de Paz, la recherche des racines indiennes comme la poésie nahuatl (Aztèque), sa philosophie, son idéalisme, le côté surréaliste (il était ami avec André Breton, entre autres), son vécu (en France, Espagne, Inde…). « L’homme n’est homme que parmi les hommes. » (p. 13).
J’ai lu la préface de Claude Roy après avoir lu le recueil parce que je voulais un œil neuf, un œil ouvert pour cette poésie mexicaine et cet auteur que je lisais pour la première fois, pour m’en imprégner, pour essayer de comprendre par moi-même, mais c’est vrai que cette préface explique des choses sur la vie, les influences (hispaniques et indiennes, révolutions mexicaine et espagnole, ouvertures sur l’Europe, les États-Unis et l’Asie) et l’œuvre d’Octavio Paz, un auteur que je relirai, c’est sûr. Grâce à un grand-père intellectuel indigéniste, à un père avocat qui voyage aux États-Unis, à une tante française qui lui fait découvrir la littérature française, Octavio Paz est, dès l’enfance, ouvert au monde, aux autres, au passé aussi. « Vie vagabonde, entre le Mexique, les États-Unis, la France, le Japon, l’Inde. » (p. 10), il a oublié l’Espagne puisque Paz y est allé durant la révolution (1937). Je comprends mieux les inspirations de Paz, la recherche des racines indiennes comme la poésie nahuatl (Aztèque), sa philosophie, son idéalisme, le côté surréaliste (il était ami avec André Breton, entre autres), son vécu (en France, Espagne, Inde…). « L’homme n’est homme que parmi les hommes. » (p. 13). Une très belle lecture (et découverte) pour
Une très belle lecture (et découverte) pour 

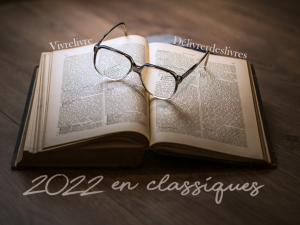 La nouvelle To Repel Boarders (À l’abordage) est un dialogue entre Paul Fairfax et Bob Kellogg. Paul est persuadé de ne pas être à sa place, de ne pas être né au bon moment, il aurait aimé vivre durant « the days of the sea-kings », c’est-à-dire à l’époque des rois de la mer. « No, honest, now, Bob, I’m sure I was born too late. The twentieth century’s no place for me. If I’d had my way… ».
La nouvelle To Repel Boarders (À l’abordage) est un dialogue entre Paul Fairfax et Bob Kellogg. Paul est persuadé de ne pas être à sa place, de ne pas être né au bon moment, il aurait aimé vivre durant « the days of the sea-kings », c’est-à-dire à l’époque des rois de la mer. « No, honest, now, Bob, I’m sure I was born too late. The twentieth century’s no place for me. If I’d had my way… ».



 L’auteur parle aussi des Halles, haut-lieu parisien (créé au début du XIIe siècle) dont aucun auteur n’a parlé depuis Zola… et il n’est pas tendre. « Paris a énormément grandi. Les Halles ont suivi le mouvement mais, malgré leur énormité, ce n’est jamais qu’un marché comme un autre et pas des plus modernes. Le ventre de Paris a tellement grandi qu’il est devenu informe et alourdit le corps, déjà colossal, de la ville, entraînant des problèmes de digestion. Les Halles sont mal organisées, peu hygiéniques et constituent une absurdité du point de vue de la circulation. » (p. 51), j’imagine que ça a évolué en bien, j’espère ! D’ailleurs les Halles avaient un peintre attitré, Narcisse Belle (1900-1967, qui était boucher charcutier aux Halles).
L’auteur parle aussi des Halles, haut-lieu parisien (créé au début du XIIe siècle) dont aucun auteur n’a parlé depuis Zola… et il n’est pas tendre. « Paris a énormément grandi. Les Halles ont suivi le mouvement mais, malgré leur énormité, ce n’est jamais qu’un marché comme un autre et pas des plus modernes. Le ventre de Paris a tellement grandi qu’il est devenu informe et alourdit le corps, déjà colossal, de la ville, entraînant des problèmes de digestion. Les Halles sont mal organisées, peu hygiéniques et constituent une absurdité du point de vue de la circulation. » (p. 51), j’imagine que ça a évolué en bien, j’espère ! D’ailleurs les Halles avaient un peintre attitré, Narcisse Belle (1900-1967, qui était boucher charcutier aux Halles). Et puis, bien sûr, il y a le Paris des artistes, Montparnasse d’abord, Saint Germain des Prés ensuite, c’est que les artistes désargentés doivent bouger lorsque le quartier devient trop cher pour qu’ils puissent continuer d’y vivre (on ne parlait pas à l’époque des bobos mais c’était déjà ce phénomène). « Ce sont les villes désertes de l’art, à Paris. C’est cela, la sociologie de l’art. » (p. 69). Mais les artistes peintres, génies ou idiots, vivent dans les même conditions que leurs prédécesseurs (l’auteur cite Gauguin et Renoir), « Ceux qui meurent ainsi de faim et grelottent de froid dans leur mansarde constatent que cela peut arriver. Pourquoi donc n’en irait-il pas de même pour eux ? Le présent est misérable, mais le rêve est riche. » (p. 73).
Et puis, bien sûr, il y a le Paris des artistes, Montparnasse d’abord, Saint Germain des Prés ensuite, c’est que les artistes désargentés doivent bouger lorsque le quartier devient trop cher pour qu’ils puissent continuer d’y vivre (on ne parlait pas à l’époque des bobos mais c’était déjà ce phénomène). « Ce sont les villes désertes de l’art, à Paris. C’est cela, la sociologie de l’art. » (p. 69). Mais les artistes peintres, génies ou idiots, vivent dans les même conditions que leurs prédécesseurs (l’auteur cite Gauguin et Renoir), « Ceux qui meurent ainsi de faim et grelottent de froid dans leur mansarde constatent que cela peut arriver. Pourquoi donc n’en irait-il pas de même pour eux ? Le présent est misérable, mais le rêve est riche. » (p. 73). L’auteur conclut en disant qu’il existe un autre Paris « nettement plus beau, celui de l’art, de l’intelligence, de la belle architecture et des boutiques de luxe. Mais ce n’est pas pour cela que je suis venu ici. Si je choisis le Paris inconnu et le revers de la médaille, ce n’est pas parce que j’ignore la beauté. » (p. 76).
L’auteur conclut en disant qu’il existe un autre Paris « nettement plus beau, celui de l’art, de l’intelligence, de la belle architecture et des boutiques de luxe. Mais ce n’est pas pour cela que je suis venu ici. Si je choisis le Paris inconnu et le revers de la médaille, ce n’est pas parce que j’ignore la beauté. » (p. 76).


 Durant l’hiver en Europe, des migrants, des Espagnols et des Italiens pour la plupart, partent moissonner chaque année en Argentine. Malgré le prix du voyage, ils gagnent plus là-bas (6 pesos par jour) que dans leur pays (quelques centimes). Les propriétaires argentins [les] appellent ‘hirondelles’ » (p. 3). Le tio (oncle) Correa, un Espagnol qui travaille en Argentine depuis trente ans, est « l’oracle des moissonneurs espagnols » (p. 4), un patriarche respecté mais ce jour-là, un homme avait eu le bras broyé et il resterait handicapé à vie. Alors Correa se lamente et se plaint…
Durant l’hiver en Europe, des migrants, des Espagnols et des Italiens pour la plupart, partent moissonner chaque année en Argentine. Malgré le prix du voyage, ils gagnent plus là-bas (6 pesos par jour) que dans leur pays (quelques centimes). Les propriétaires argentins [les] appellent ‘hirondelles’ » (p. 3). Le tio (oncle) Correa, un Espagnol qui travaille en Argentine depuis trente ans, est « l’oracle des moissonneurs espagnols » (p. 4), un patriarche respecté mais ce jour-là, un homme avait eu le bras broyé et il resterait handicapé à vie. Alors Correa se lamente et se plaint… Bref, un jour, un chérubin prévient Ève que, s’il ne pleut pas, le Créateur viendra leur rendre visite sur Terre. C’est pourquoi elle choisit, parmi la centaine d’enfants, ses quatre préférés « et elle les débarbouilla, les habilla le mieux qu’elle put. Puis, avec force bourrades, elle poussa tous les autres dans une étable et les y enferma sous clef, malgré leurs protestations. » (p. 23). Arrivent l’escorte, les archanges et le Seigneur avec les anges et les hauts dignitaires de la cour céleste… Le Seigneur ne veut pas revenir sur la punition qu’il a infligée à Adam et Ève mais il considère que leurs enfants sont innocents donc il veut leur faire un cadeau à chacun mais… « Quatre enfants seulement ? ― s’étonna le Seigneur. ― Je vous croyais une descendance plus nombreuse. Mes cadeaux ne me ruineront pas. Allons, petits, approchez. » (p. 27).
Bref, un jour, un chérubin prévient Ève que, s’il ne pleut pas, le Créateur viendra leur rendre visite sur Terre. C’est pourquoi elle choisit, parmi la centaine d’enfants, ses quatre préférés « et elle les débarbouilla, les habilla le mieux qu’elle put. Puis, avec force bourrades, elle poussa tous les autres dans une étable et les y enferma sous clef, malgré leurs protestations. » (p. 23). Arrivent l’escorte, les archanges et le Seigneur avec les anges et les hauts dignitaires de la cour céleste… Le Seigneur ne veut pas revenir sur la punition qu’il a infligée à Adam et Ève mais il considère que leurs enfants sont innocents donc il veut leur faire un cadeau à chacun mais… « Quatre enfants seulement ? ― s’étonna le Seigneur. ― Je vous croyais une descendance plus nombreuse. Mes cadeaux ne me ruineront pas. Allons, petits, approchez. » (p. 27).
 Yakup Kadri Karaosmanoglu naît au Caire (Égypte) le 27 mars 1889 dans une famille ottomane. Il étudie le français et le Droit mais préfère se consacrer à sa passion, l’écriture. Il publie des nouvelles et des poèmes en prose dans plusieurs journaux d’Istanbul mais, suite à la défaite de l’empire ottoman en 1918 et à l’occupation de la Turquie par les Alliés, il préfère entrer dans la résistance et rejoindre les troupes kémalistes en Anatolie. En 1922, il publie un roman politique et social qui annonce la modernité de la Turquie, Kiralik konak (Demeure à louer) et en 1923, lorsque le gouvernement d’Atatürk est mis en place, on le retrouve député au parlement républicain puis il accepte sans grande motivation un poste de diplomate. Il fonde la revue Kadro, revue politique kémaliste et littéraire sociale, en 1932, avec quatre amis intellectuels de gauche. Après avoir consacré les dernières années de sa vie à rédiger ses mémoires de diplomate et d’homme de lettres, il meurt à Ankara (Turquie) le 13 décembre 1974. Il est considéré comme un des grands romanciers turcs de la première moitié du XXe siècle, bien qu’il soit aussi journaliste, poète, nouvelliste et dramaturge.
Yakup Kadri Karaosmanoglu naît au Caire (Égypte) le 27 mars 1889 dans une famille ottomane. Il étudie le français et le Droit mais préfère se consacrer à sa passion, l’écriture. Il publie des nouvelles et des poèmes en prose dans plusieurs journaux d’Istanbul mais, suite à la défaite de l’empire ottoman en 1918 et à l’occupation de la Turquie par les Alliés, il préfère entrer dans la résistance et rejoindre les troupes kémalistes en Anatolie. En 1922, il publie un roman politique et social qui annonce la modernité de la Turquie, Kiralik konak (Demeure à louer) et en 1923, lorsque le gouvernement d’Atatürk est mis en place, on le retrouve député au parlement républicain puis il accepte sans grande motivation un poste de diplomate. Il fonde la revue Kadro, revue politique kémaliste et littéraire sociale, en 1932, avec quatre amis intellectuels de gauche. Après avoir consacré les dernières années de sa vie à rédiger ses mémoires de diplomate et d’homme de lettres, il meurt à Ankara (Turquie) le 13 décembre 1974. Il est considéré comme un des grands romanciers turcs de la première moitié du XXe siècle, bien qu’il soit aussi journaliste, poète, nouvelliste et dramaturge.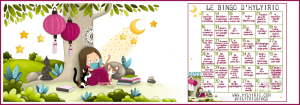 Mon résumé – Ahmet Celal est un jeune officier brillant mais amputé d’un bras au cours de la première guerre mondiale, il fuit Istanbul occupée par les Alliés et une vie citadine qu’il ne supporte plus. Il se retire dans un petit village de la steppe anatolienne et découvre avec horreur le monde rural. De leur côté, les paysans le considèrent comme un étranger dans son propre pays. En 1921, avec la guerre d’indépendance, il se dit que les Alliés arriveront inévitablement en Anatolie et décide de fuir à nouveau. Emine, la femme qu’il aime étant blessée, il est obligé de l’abandonner mais lui laisse un cahier. C’est le journal intime que cet homme tenait sur le cahier que les lecteurs peuvent lire et qui leur permet de découvrir une Turquie en plein bouleversement.
Mon résumé – Ahmet Celal est un jeune officier brillant mais amputé d’un bras au cours de la première guerre mondiale, il fuit Istanbul occupée par les Alliés et une vie citadine qu’il ne supporte plus. Il se retire dans un petit village de la steppe anatolienne et découvre avec horreur le monde rural. De leur côté, les paysans le considèrent comme un étranger dans son propre pays. En 1921, avec la guerre d’indépendance, il se dit que les Alliés arriveront inévitablement en Anatolie et décide de fuir à nouveau. Emine, la femme qu’il aime étant blessée, il est obligé de l’abandonner mais lui laisse un cahier. C’est le journal intime que cet homme tenait sur le cahier que les lecteurs peuvent lire et qui leur permet de découvrir une Turquie en plein bouleversement. J’espère que ça vous donne des idées pour le
J’espère que ça vous donne des idées pour le