 Contre la barbarie 1925-1948 de Klaus Mann.
Contre la barbarie 1925-1948 de Klaus Mann.
Phébus, collection Littérature étrangère, mars 2009, 368 pages, 23,35 €, ISBN 978-2-7529-0317-4. Articles et essais traduits de l’allemand par Corinna Gepner et Dominique Laure Miermont.
Genres : littérature allemande, essais, Histoire.
Klaus Mann de son vrai nom Klaus Heinrich Thomas Mann, naît le 18 novembre 1906 à Munich en Bavière (en Allemagne). Je remets plus ou moins ce que j’ai écrit pour Correspondance 1925-1941 de Stefan Zweig et Klaus Mann. Il est issu d’une famille juive, bourgeoise et intellectuelle, son père Thomas Mann et son oncle Heinrich Mann sont écrivains, sa sœur aînée Erika et son jeune frère Golo aussi. Son premier roman, La danse pieuse, est le premier roman allemand homosexuel. Juif, homosexuel, il est bien conscient des dangers du nazisme et quitte l’Allemagne en mars 1933, d’abord pour la Tchécoslovaquie puis pour les États-Unis (où il s’enrôle dans l’armée). Il est principalement romancier, nouvelliste, journaliste et dramaturge mais aussi poète, diariste et critique littéraire. Il voyage beaucoup avec Erika, fonde une revue littéraire à Amsterdam (en Hollande), lutte contre le nazisme et le franquisme (vous pouvez lire tout ça dans sa correspondance). L’après-guerre est difficile et nombre de ses amis se sont suicidés (dont Stefan Zweig) alors il se suicide le 21 mai 1949 dans la pension de famille où il réside à Cannes. Il laisse à la postérité une œuvre incroyable, éclectique et sensible à découvrir.
« Pourquoi ce livre ? Parce que l’essayiste et inlassable chroniqueur de son temps que fut Klaus Mann est encore très mal connu en France. On se souvient du Tournant, cette prodigieuse fresque autobiographique ; du roman Mephisto qui a fait, à l’image de son héros, une carrière brillante et mouvementée ; et il y a quelques années, de son étonnant et émouvant Journal. Dans des formes et des styles très divers, ces ouvrages révèlent un écrivain engagé corps et âme dans les problèmes de son époque. Mais il est un domaine dans lequel Klaus Mann a excellé, manifestant au fil des jours toute la vivacité de son esprit et la pertinence de ses engagements : la chronique et l’essai. Son insatiable curiosité intellectuelle et sa combativité naturelle nous en ont légué plusieurs centaines, sur tous les sujets littéraires, artistiques et politiques qui agitèrent le monde entre les deux guerres et jusqu’en 1949, année de son suicide à Cannes. » (extrait de l’introduction par Dominique Laure Miermont, p. 7).
« Autant aller à l’essentiel : cette lettre de Klaus Mann adressée à Stefan Zweig en octobre 1930, juste après le succès électoral des nazis au Reichstag, succès étourdissant, jugé par Zweig dans un article comme un signal de la jeunesse ‘contre les lenteurs de la haute politique’. Zweig trouve ‘naturelle’ cette révolte des jeunes ; ce ne serait que pour ses goûts personnels, il n’y mettrait bien sûr pas le petit doigt, mais il est d’humeur compréhensive. Les jeunes… La réponse de Klaus Mann à l’illustre auteur est cinglante : ‘Tout ce que fait la jeunesse ne nous montre pas la voie de l’avenir. Moi qui dis cela, je suis jeune moi-même. La plupart des gens de mon âge – ou des gens encore plus jeunes – ont fait, avec l’enthousiasme qui devrait être réservé au progrès, le choix de la régression. C’est une chose que nous ne pouvons sous aucun prétexte approuver. Sous aucun prétexte.’ Toute la suite de cette réponse est un prodige d’insolence respectueuse, de lucidité ardente […]. De 1930 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Klaus Mann n’aura donc cessé de secouer le cocotier, il a vu, il a senti tout de suite que l’atmosphère n’était pas bonne du tout. » et « D’une certaine manière, Klaus Mann est une incarnation bouleversante du XXe siècle dans tout ce qu’il peut avoir à la fois d’ardent et de désespéré. » (extraits de Klaus Mann, l’antitotalitaire, la préface de Michel Crépu, p. 9 puis p. 12).
 Ce recueil regroupe 67 textes extraits des 5 tomes (2200 pages en tout) parus entre 1992 et 1994 en Allemagne aux éditions Rowohlt fondées à Reinbek en 1908 et dont le siège est à Hambourg depuis 2019. La majorité de ces textes est parue du vivant de l’auteur mais une autre partie non publiée est conservée aux archives de la bibliothèque de Munich, voir sur Thomas Mann International. À noter que Klaus Mann, exilé aux États-Unis, a écrit plusieurs textes en anglais dès 1940.
Ce recueil regroupe 67 textes extraits des 5 tomes (2200 pages en tout) parus entre 1992 et 1994 en Allemagne aux éditions Rowohlt fondées à Reinbek en 1908 et dont le siège est à Hambourg depuis 2019. La majorité de ces textes est parue du vivant de l’auteur mais une autre partie non publiée est conservée aux archives de la bibliothèque de Munich, voir sur Thomas Mann International. À noter que Klaus Mann, exilé aux États-Unis, a écrit plusieurs textes en anglais dès 1940.
Je ne peux que saluer – honorer même avec cette deuxième lecture – cet homme, Allemand de naissance et Européen de cœur, auteur et intellectuel de son temps mais aussi en avance sur son temps, sincère et intègre, un humaniste aimant le beau et la liberté, qui toute sa vie s’est battu contre la barbarie, contre les totalitarismes et qui a essayé d’ouvrir les yeux de ses contemporains… parfois plus ou moins aveugles et sourds face aux dangers. Les textes sont présentés par ordre chronologique.
Le premier jour, article paru dans 8 Uhr-Abendblatt de Berlin le 14 avril 1925, raconte le premier jour du voyage que Klaus Mann a fait à Paris au printemps 1925. Il n’a pas 20 ans et il écrit déjà des articles, en particulier littéraires, pour des journaux. « Certaines villes mettent des jours, d’autres des semaines à dévoiler leur spécificité et leur charme. Paris convainc et même subjugue en quelques heures […] émerveillé […] sortilèges de la capitale. » (p. 16). On parle ici du Paris d’il y a presque 100 ans (que, personnellement, je n’ai pas du tout ressenti comme tel au début des années 2000) et ça m’a fait penser à Ivar Lo-Johansson (Suédois) et à George Orwell (Anglais) qui, dans les années 1920, y ont vécu dans la misère, lire L’Autre Paris d’Ivar Lo-Johansson et Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell mais Klaus Mann avait bien le droit de penser que Paris était « la splendeur de l’Europe » (p. 17).
Réponse à une enquête menée auprès des jeunes écrivains sur leurs tendances artistiques, article paru dans Die Kolonne en février 1930, dans lequel Klaus Mann montre que la jeunesse confond art avec actes militants et politiques. « De nos jours, tout art sans exception doit être de la ‘propagande politique’, dans l’acceptation la plus large du terme. […] c’est une méprise très en vogue, surtout à Berlin, de considérer une œuvre d’art comme légitime uniquement si elle combat […]. La valeur militante sert volontiers d’excuse à l’absence la plus flagrante de dimension artistique […]. » (p. 18) et « être conscient de sa mission militante » oui mais « renoncer à sa qualité d’artiste » non (p. 19).
Jeunesse et radicalisme, une réponse à Stefan Zweig (1931) dont j’ai déjà parlé pour Correspondance 1925-1941 de Stefan Zweig et Klaus Mann.
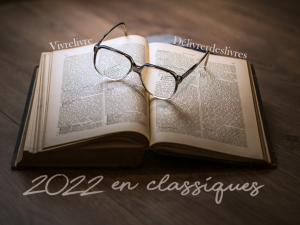 Est-ce l’avènement du ‘Troisième Reich’ ?, article paru dans Die Literatur en avril 1931, dans lequel Klaus Mann donne son avis sur deux essais parus aux éditions Rowohlt, Est-ce l’avènement du Troisième Reich ? de Walter Oehme et Kurt Caro et Adolf Hitler, Guillaume III de Weigand von Miltenberg. Oehme et Caro, journalistes qui quitteront l’Allemagne en 1933, demandent pourquoi un parti qui se veut socialiste se fait financer par la grande industrie donc le capitalisme, « Quelle sinistre imposture ! […] Quelle triste jeunesse ! » (p. 24) déplore Mann.
Est-ce l’avènement du ‘Troisième Reich’ ?, article paru dans Die Literatur en avril 1931, dans lequel Klaus Mann donne son avis sur deux essais parus aux éditions Rowohlt, Est-ce l’avènement du Troisième Reich ? de Walter Oehme et Kurt Caro et Adolf Hitler, Guillaume III de Weigand von Miltenberg. Oehme et Caro, journalistes qui quitteront l’Allemagne en 1933, demandent pourquoi un parti qui se veut socialiste se fait financer par la grande industrie donc le capitalisme, « Quelle sinistre imposture ! […] Quelle triste jeunesse ! » (p. 24) déplore Mann.
Ne rien faire…, article paru dans 8 Uhr-Abendblatt de Berlin le 19 octobre 1931, explique que le peuple allemand n’est pas paresseux mais 25 % des actifs sont au chômage à cause de la crise de 1929 et que « l’ennui est un spectre plus malfaisant que le dénuement. » (p. 26), « mise à l’écart […] amertume […] injustice sans égale » (p. 27), « Ce qui est sûr, c’est qu’à la longue, il aimera mieux faire le mal que de ne rien faire… » (p. 28).
Jumeaux de pathologie sexuelle, article paru dans Das Tagebuch le 31 décembre 1931, dans lequel Klaus Mann explique que le magazine français VU a publié un numéro spécial sur l’Allemagne et « a consacré une illustration à cette curiosité qui lui paraît typiquement berlinoise » (p. 29), la librairie de sexologie. De façon amusante, Mann montre comment le libraire allie sexualité et politique.
Munich, mars 1933, tapuscrit conservé dans le fonds Klaus Mann à Munich (cité et linké plus haut). « Le 10 mars 1933. Nous étions allés faire du ski en Suisse. » (p. 31) mais le retour à Munich est tendu… « Munich a l’air calme. Mais lorsqu’on tend l’oreille, on sent la tension, l’inquiétude de tous ces gens […], une tension qui pour beaucoup est sûrement joyeuse et confiante en l’avenir, mais pour bien d’autres désespérée. […] Munich était une oasis. Cela ne pouvait pas durer. » (p. 32). « Les conversations téléphoniques sont surveillées […]. Nombre de ceux avec qui l’ont veut prendre contact ont déjà été arrêtés […]. » (p. 33). Le 13 mars, les Mann quittent l’Allemagne.
Culture et ‘bolchevisme culturel’, avril 1933, tapuscrit conservé dans le fonds Klaus Mann à Munich. Dans ‘la nouvelle Allemagne’, il est plus facile d’être contre que pour, « contre le marxisme, contre le traité de Versailles, contre les Juifs » (p. 34). Le ‘bolchevik culturel’ n’est pas que le communiste, il est « motif à suspicion […] et mérite de mourir parce qu’il est ‘anti-allemand’, ‘réfractaire’, ‘judéo-analytique’, dépourvu de respect devant les bonnes vieilles traditions (à savoir les corporations étudiantes et les défilés militaires), pas ‘assez attaché à la terre’, pas assez ‘dynamique’ et de ce fait – de tous les reproches le plus épouvantable – ‘pacifiste’ ! [Il] s’est ligué avec la France, les Juifs et l’Union soviétique. […] à la fois marxiste et anarchiste (on met tout dans le même sac). Il reçoit tous les jours de l’argent des francs-maçons, des sionistes et de Staline. Il faut l’exterminer. » (p. 35). Bref, soit vous êtes un nazi convaincu et convainquant soit vous êtes un ennemi… Mann note ‘la nouvelle Allemagne’, les nouveaux idéaux et le nouveau jargon typique d’une société totalitaire. Rien de réjouissant donc dans cette nouvelle Allemagne avec des écoles respectées, libres et humanistes, fondées « sur les valeurs de fraternité et de démocratie » (note, p. 35) fermées, la science et les universités également menacées, et la « presse allemande n’existe plus, toute liberté d’expression, même la plus modeste, est réprimée avec un radicalisme remarquable (qui surpasse encore, s’il est possible, celui des Italiens). Les journaux des partis de gauche sont […] tous interdits. La ‘grande presse libérale’ est […] contrainte d’emboucher la trompette fasciste […] elle a succombé sans la moindre résistance à une mort peu glorieuse et bien méritée. […] Sont évidemment interdites les revues ayant conservé jusqu’au bout une attitude courageuse et un niveau élevé : Tagebuch et Weltbühne. Leurs éditeurs sont en fuite ou en prison. » (p. 37), et je passe sur plusieurs exactions et propagande (littérature, théâtre, cinéma, radios, musique, peinture, architecture…), ou comment niquer la culture et l’art, désinformer et tromper tout un peuple. « On le voit, rien n’est oublié […]. » (p. 40). Un titre à lire absolument parce qu’on n’est malheureusement pas à l’abri de ce genre d’idées nauséabondes et contre-productives…
 Lettre à Gottfried Benn, lettre personnelle de Klaus Mann à Gottfried Benn « qui connut un bref engouement pour l’idéologie nazie entre 1933-1934 » (p. 41), qui répondit par Réponse aux écrivains en exil (diffusée à la radio le 24 mai 1933 et publiée le 26 mai 1933 dans le Deutsche Allgemeine Zeitung, et lettre publiée par Gottfried Benn dans Dopelleben en 1950). Klaus Mann questionne Gottfried Benn (auteur allemand que je ne connais pas) qui n’a pas démissionné de l’Académie dont plusieurs de ses amis, dont Heinrich Mann (l’oncle de Klaus Mann) « s’est fait honteusement renvoyer » (p. 42).
Lettre à Gottfried Benn, lettre personnelle de Klaus Mann à Gottfried Benn « qui connut un bref engouement pour l’idéologie nazie entre 1933-1934 » (p. 41), qui répondit par Réponse aux écrivains en exil (diffusée à la radio le 24 mai 1933 et publiée le 26 mai 1933 dans le Deutsche Allgemeine Zeitung, et lettre publiée par Gottfried Benn dans Dopelleben en 1950). Klaus Mann questionne Gottfried Benn (auteur allemand que je ne connais pas) qui n’a pas démissionné de l’Académie dont plusieurs de ses amis, dont Heinrich Mann (l’oncle de Klaus Mann) « s’est fait honteusement renvoyer » (p. 42).
Réponse à la ‘Réponse’, 31 mai 1933, tapuscrit conservé dans le fonds Klaus Mann à Munich. Il faudrait lire Gottfried Benn pour savoir ce qu’il a répondu à la lettre de Klaus Mann mais, en tout cas, Mann écrit une réponse indignée et sincère, « les propos de Benn [sont] épouvantablement symptomatiques » (p. 46). Comment Benn peut-il décrire « Hitler comme un génie » (p. 46) ? « Comme si, pendant des années, nous n’avions pas entendu à la radio, discours après discours, les menaces proférées par une horde de sauvages contre les idéaux de l’humanité. Maintenant nous y sommes, la menace a pris le pouvoir, la barbarie est totale. » (p. 46). « Quel avilissement d’un énorme talent – je trouve cela poignant ! […] platitude […] perfidie […] cynisme […] » (p. 47).
Die Sammlung, éditorial publié en septembre 1933 dans le 1er n° de cette revue littéraire fondée par Klaus Mann et la Suissesse Annemarie Schwarzenbach, aux éditions Querido à Amsterdam, dont j’ai déjà parlé pour Correspondance 1925-1941 de Stefan Zweig et Klaus Mann. Cent cinquante écrivains (principalement européens mais aussi des Amériques) ont participé à cette revue qui sera publiée pendant deux ans. « La présente revue sera au service de la littérature, cette chose élevée qui ne concerne pas seulement un peuple mais tous les peuples de la Terre. » (p. 50). « Une revue littéraire n’est pas une revue politique […]. Il n’empêche que cette revue aura une mission politique. Son orientation doit être dénuée de toute équivoque. Ceux qui prendront la peine de suivre les différents numéros de notre revue ne doivent douter ni de notre position à nous, les éditeurs, ni de celle de nos collaborateurs. Il faut que dès le début nous disions clairement ce que nous abhorrons et ce que nous espérons être en droit d’aimer. » (p. 51).
Gottgried Benn ou l’avilissement de l’esprit, article paru en septembre 1933 dans le 1er n° de Die Sammlung (Le Rassemblement). Suite à une lettre privée de Klaus Mann à Gottfried Benn, celui-ci répondit par une lettre ouverte intitulée Aux émigrés qu’il diffusa à la radio et publia dans un journal (voir ci-dessus). En plus de l’amitié, de l’admiration et de l’estime perdues, Klaus Mann déplore ici la platitude, l’indigence intellectuelle de Benn ce qui est « encore plus pernicieux. » (p. 53), il déplore aussi une « Allemagne violentée » (p. 54) par l’absurdité, la démagogie…
Réponse aux attaques contre la revue Die Sammlung, 14 octobre 1933, tapuscrit conservé dans le fonds Klaus Mann à Munich. Sur l’influence de leur éditeur allemand, des auteurs allemands dont le père de Klaus Mann, Thomas Mann, se sont dédits de leur collaboration littéraire. Après avoir reçu une lettre de Romain Rolland surpris par ces désistements, Klaus Mann rédige cette réponse qui n’a finalement pas été publiée. « Mais il y a des situations où il est plus convenable de se taire, même s’il serait plus profitable de parler. » (p. 56-57).
88 au pilori, article paru en novembre 1933 dans Das Neue Tage-Buch. 88 écrivains allemands ont fait allégeance au régime nazi et, à part Gottfried Benn (cité plus haut) et qui était déjà célèbre avant, « aucun des signataires n’est passé à la postérité » (p. 59). « Il se sont cloués eux-mêmes au pilori » (p. 59) écrit Klaus Mann.
 À l’intérieur et à l’extérieur, article paru en novembre 1933 dans Deutsche Stimmen. « Pour un homme intellectuellement honnête, il doit être terrible de vivre dans ce pays. Il lui faut obéir aux caprices de la force et de la confusion, et ce sans relâche. » (p. 61). « L’émigration n’est pas une aventure distrayante, et ce qui nous attend risque d’être plus difficile que tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Je me dis pourtant que notre situation est magnifique comparée à celle des humiliés de l’intérieur. » (p. 64).
À l’intérieur et à l’extérieur, article paru en novembre 1933 dans Deutsche Stimmen. « Pour un homme intellectuellement honnête, il doit être terrible de vivre dans ce pays. Il lui faut obéir aux caprices de la force et de la confusion, et ce sans relâche. » (p. 61). « L’émigration n’est pas une aventure distrayante, et ce qui nous attend risque d’être plus difficile que tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Je me dis pourtant que notre situation est magnifique comparée à celle des humiliés de l’intérieur. » (p. 64).
Dimitroff, 14 décembre 1933, manuscrit conservé dans le fonds Klaus Mann à Munich. Georgi Dimitroff (1882-1949) est un communiste bulgare et un des deux accusés de l’incendie du Reichstag. Sous la pression internationale, Georgi Dimitroff et Ernst Torgler furent acquittés.
Esprit de logique, article paru en décembre 1933 dans Der Gegen-Angriff. Le régime nazi pensait que les femmes qui fumaient étaient vulgaires et leur a donc interdit de fumer jusqu’à ce « que les fabricants de cigarettes le lui permirent. Ceux-ci furent les seuls à protester. » (p. 68). J’ai envie de dire lol mais c’est un anachronisme ! L’industrie et les finances dont plus importantes que la vulgarité ou la santé, c’est logique ! Klaus Mann parle aussi de l’hypocrisie et du cynisme envers les Juifs, il ne faudrait pas « entraîner un déficit d’impôts » (p. 69).
 Oh la la, ma note de lecture est déjà super longue, 5 pages de traitement de texte (sûrement une des trois plus longues que j’ai rédigées) et je ne suis pas sûre que WordPress autorise les billets si longs… Je n’ai qu’une chose à dire : je continue évidemment la lecture du livre et je vous invite chaleureusement à lire ces 67 textes plus ou moins longs mais tous très enrichissants tant au niveau humain qu’historique et littéraire. Klaus Mann est un très grand écrivain que je suis vraiment contente d’avoir découvert pour Les feuilles allemandes, auteur découvert grâce à Eva et, si ce livre vous paraît trop dense, vous pouvez toujours vous replier vers Mise en garde présenté par Eva qui est une sélection peut-être plus abordable (en tout cas, plus courte) du talent de journaliste et d’essayiste de Klaus Mann, un homme intègre, investi, et ce dès son plus jeune âge. Il émanait certainement de lui, une aura, une puissance dont sont faits les grands hommes, les visionnaires, les héros, ceux qui se battent pour la vérité, la paix, la liberté, la beauté et l’art. C’était, je pense, toute sa vie, sa vocation et son style est magnifique, d’une grande précision et d’une grande beauté, avec un certain lyrisme mais ce qu’il faut, pas appuyé et ronflant, il fait preuve aussi d’humour (quand c’est possible), bref à lire, à découvrir et même à relire parce que ses textes restent (malheureusement) d’actualité près de 100 ans après. Il y a en milieu de volume un cahier de 8 pages avec des photos en noir et blanc ; j’aime beaucoup la première, Klaus Mann à Uttwil en 1926, photographié par Thea Sternheim (si je la retrouve sur internet, je la mets ci-contre).
Oh la la, ma note de lecture est déjà super longue, 5 pages de traitement de texte (sûrement une des trois plus longues que j’ai rédigées) et je ne suis pas sûre que WordPress autorise les billets si longs… Je n’ai qu’une chose à dire : je continue évidemment la lecture du livre et je vous invite chaleureusement à lire ces 67 textes plus ou moins longs mais tous très enrichissants tant au niveau humain qu’historique et littéraire. Klaus Mann est un très grand écrivain que je suis vraiment contente d’avoir découvert pour Les feuilles allemandes, auteur découvert grâce à Eva et, si ce livre vous paraît trop dense, vous pouvez toujours vous replier vers Mise en garde présenté par Eva qui est une sélection peut-être plus abordable (en tout cas, plus courte) du talent de journaliste et d’essayiste de Klaus Mann, un homme intègre, investi, et ce dès son plus jeune âge. Il émanait certainement de lui, une aura, une puissance dont sont faits les grands hommes, les visionnaires, les héros, ceux qui se battent pour la vérité, la paix, la liberté, la beauté et l’art. C’était, je pense, toute sa vie, sa vocation et son style est magnifique, d’une grande précision et d’une grande beauté, avec un certain lyrisme mais ce qu’il faut, pas appuyé et ronflant, il fait preuve aussi d’humour (quand c’est possible), bref à lire, à découvrir et même à relire parce que ses textes restent (malheureusement) d’actualité près de 100 ans après. Il y a en milieu de volume un cahier de 8 pages avec des photos en noir et blanc ; j’aime beaucoup la première, Klaus Mann à Uttwil en 1926, photographié par Thea Sternheim (si je la retrouve sur internet, je la mets ci-contre).
Ce livre entre aussi dans les challenges 2022 en classiques, Petit Bac 2022 (catégorie Chiffre pour 1925-1948) et ABC illimité (je profite du K de Klaus pour honorer la lettre à prénom).
 Moi, je veux être une sorcière – Ménopause, le dernier tabou de Marie Pavlenko et Joséphine Onteniente.
Moi, je veux être une sorcière – Ménopause, le dernier tabou de Marie Pavlenko et Joséphine Onteniente. La citation en entête fait peur… « ‘Pas vraiment homme, pas non plus femme fonctionnelle, ces individus* vivent dans un monde d’intersexe. Ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu’être humain.’ Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, David Reuben, 1969. *Les femmes ménopausées donc… » ! (p. 5).
La citation en entête fait peur… « ‘Pas vraiment homme, pas non plus femme fonctionnelle, ces individus* vivent dans un monde d’intersexe. Ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu’être humain.’ Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, David Reuben, 1969. *Les femmes ménopausées donc… » ! (p. 5). Pour Un mois au Japon. Au Japon, la ménopause n’existe pas : les Japonais parlent de konenki. « Ce terme recouvre bien plus que l’arrêt des règles. Il englobe le blanchiment des cheveux, le corps qui se transforme peu à peu, la vue qui baisse, etc. ‘La notion de konenki n’est ni sexuée ni associée à une période de la vie : les hommes comme les femmes passent par le konenki’, note Cécile Charlap. Les femmes ne sont donc pas mises sur la touche et montrées du doigt sous prétexte qu’elles ne peuvent plus avoir d’enfants. La période considérée est plus large, globale, et dès lors, moins discriminatoire. » (p. 66-67). J’aime le Japon, les Japonais et leur respect des personnes âgées ! Je ne suis pas invisible, je ne suis pas malade, je ne suis pas fragile (cf. l’industrie pharmaceutique, p. 74).
Pour Un mois au Japon. Au Japon, la ménopause n’existe pas : les Japonais parlent de konenki. « Ce terme recouvre bien plus que l’arrêt des règles. Il englobe le blanchiment des cheveux, le corps qui se transforme peu à peu, la vue qui baisse, etc. ‘La notion de konenki n’est ni sexuée ni associée à une période de la vie : les hommes comme les femmes passent par le konenki’, note Cécile Charlap. Les femmes ne sont donc pas mises sur la touche et montrées du doigt sous prétexte qu’elles ne peuvent plus avoir d’enfants. La période considérée est plus large, globale, et dès lors, moins discriminatoire. » (p. 66-67). J’aime le Japon, les Japonais et leur respect des personnes âgées ! Je ne suis pas invisible, je ne suis pas malade, je ne suis pas fragile (cf. l’industrie pharmaceutique, p. 74). Quelques mots sur les dessins de Joséphine Onteniente (je ne connaissais pas cette dessinatrice) : ils sont spéciaux, oui, mais ils illustrent très bien le propos, sans faux-semblants et sans tabou !
Quelques mots sur les dessins de Joséphine Onteniente (je ne connaissais pas cette dessinatrice) : ils sont spéciaux, oui, mais ils illustrent très bien le propos, sans faux-semblants et sans tabou !

 Ce livre m’a fait beaucoup de bien et m’a fait comprendre beaucoup de choses (émotions, vécu, enfance, amertume et ressentiment…). « Au risque de me répéter, plus on a conscience de ses émotions négatives et plus on les reconnaît, en meilleure santé on est. » (p. 132). Et, si vous lisez ce livre, parce que vous en avez besoin (comme moi) ou simplement parce que vous êtes curieux, j’espère qu’il vous fera du bien aussi et qu’il vous fera comprendre des choses indispensables sur les émotions et la (les) façon(s) de les appréhender et de les gérer sans culpabilité ni anxiété.
Ce livre m’a fait beaucoup de bien et m’a fait comprendre beaucoup de choses (émotions, vécu, enfance, amertume et ressentiment…). « Au risque de me répéter, plus on a conscience de ses émotions négatives et plus on les reconnaît, en meilleure santé on est. » (p. 132). Et, si vous lisez ce livre, parce que vous en avez besoin (comme moi) ou simplement parce que vous êtes curieux, j’espère qu’il vous fera du bien aussi et qu’il vous fera comprendre des choses indispensables sur les émotions et la (les) façon(s) de les appréhender et de les gérer sans culpabilité ni anxiété.
 L’autrice raconte sa grand-mère, « l’âge d’or des années 30 à Bucarest , [… sa] jeunesse étincelante […] sa famille remarquable, sa ville pimpante, Bucarest dite le ‘petit Paris des Balkans’ dans l’entre-deux-guerres. » (p. 23-24), l’antisémitisme politique et la diabolisation du juif, la montée du fascisme à la fin des années 1930, la Seconde guerre mondiale au côté de l’Allemagne, purification ethnique, retournement opportuniste… « La Roumanie fut le premier bras armé des nazis, à l’Est, et leur alliée la plus zélée. » (p. 53). Et puis, le silence de tous les côtés, les non-dits, le « si on n’en parle pas, c’est que ça n’existe pas. » (p. 64) et « Du passé faisons table rase. […] plus de nom juif, plus de juif. Et inversement. » (p. 72).
L’autrice raconte sa grand-mère, « l’âge d’or des années 30 à Bucarest , [… sa] jeunesse étincelante […] sa famille remarquable, sa ville pimpante, Bucarest dite le ‘petit Paris des Balkans’ dans l’entre-deux-guerres. » (p. 23-24), l’antisémitisme politique et la diabolisation du juif, la montée du fascisme à la fin des années 1930, la Seconde guerre mondiale au côté de l’Allemagne, purification ethnique, retournement opportuniste… « La Roumanie fut le premier bras armé des nazis, à l’Est, et leur alliée la plus zélée. » (p. 53). Et puis, le silence de tous les côtés, les non-dits, le « si on n’en parle pas, c’est que ça n’existe pas. » (p. 64) et « Du passé faisons table rase. […] plus de nom juif, plus de juif. Et inversement. » (p. 72). Après la guerre, et après la création de l’État d’Israël (qui s’était tourné vers les États-Unis et non l’Union Soviétique), Staline ne voulant pas être accusé d’antisémitisme créa le cosmopolitisme, « cosmopolites sans racine […] intellectuels juifs dits ‘apatrides’, des juifs ‘errants’, sans attaches, donc perpétuellement soupçonnés d’ ‘antipatriotisme’ ou de ‘traîtrise à la patrie’ » (p. 106), c’est bizarre, malgré tout ce que j’ai déjà lu et tous les documentaires que j’ai vus, je n’avais jamais entendu parler de ça ou alors le terme ‘cosmopolitisme’ était abordé avec un autre mot. Je n’avais également jamais entendu parler de Matatias Carp (1904-1953) ou alors j’ai oublié (son Cartea neagră, le livre noir de la destruction des Juifs de Roumanie, 1940-1944 est pourtant paru chez Denoël en 2009).
Après la guerre, et après la création de l’État d’Israël (qui s’était tourné vers les États-Unis et non l’Union Soviétique), Staline ne voulant pas être accusé d’antisémitisme créa le cosmopolitisme, « cosmopolites sans racine […] intellectuels juifs dits ‘apatrides’, des juifs ‘errants’, sans attaches, donc perpétuellement soupçonnés d’ ‘antipatriotisme’ ou de ‘traîtrise à la patrie’ » (p. 106), c’est bizarre, malgré tout ce que j’ai déjà lu et tous les documentaires que j’ai vus, je n’avais jamais entendu parler de ça ou alors le terme ‘cosmopolitisme’ était abordé avec un autre mot. Je n’avais également jamais entendu parler de Matatias Carp (1904-1953) ou alors j’ai oublié (son Cartea neagră, le livre noir de la destruction des Juifs de Roumanie, 1940-1944 est pourtant paru chez Denoël en 2009). « Je ne sais pas très précisément ce que c’est qu’être juif, ce que ça me fait d’être juif. C’est une évidence, si l’on veut, mais une évidence médiocre, qui ne me rattache à rien. Ce n’est pas un signe d’appartenance, ce n’est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude. Une certitude inquiète derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable : celle d’avoir été désigné comme juif, et parce que juif victime, de ne devoir la vie qu’au hasard et à l’exil. », très belle citation de Georges Perec (p. 258-259).
« Je ne sais pas très précisément ce que c’est qu’être juif, ce que ça me fait d’être juif. C’est une évidence, si l’on veut, mais une évidence médiocre, qui ne me rattache à rien. Ce n’est pas un signe d’appartenance, ce n’est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude. Une certitude inquiète derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable : celle d’avoir été désigné comme juif, et parce que juif victime, de ne devoir la vie qu’au hasard et à l’exil. », très belle citation de Georges Perec (p. 258-259). Pour
Pour 

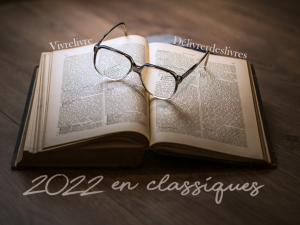 Est-ce l’avènement du ‘Troisième Reich’ ?, article paru dans Die Literatur en avril 1931, dans lequel Klaus Mann donne son avis sur deux essais parus aux éditions Rowohlt, Est-ce l’avènement du Troisième Reich ? de Walter Oehme et Kurt Caro et Adolf Hitler, Guillaume III de Weigand von Miltenberg. Oehme et Caro, journalistes qui quitteront l’Allemagne en 1933, demandent pourquoi un parti qui se veut socialiste se fait financer par la grande industrie donc le capitalisme, « Quelle sinistre imposture ! […] Quelle triste jeunesse ! » (p. 24) déplore Mann.
Est-ce l’avènement du ‘Troisième Reich’ ?, article paru dans Die Literatur en avril 1931, dans lequel Klaus Mann donne son avis sur deux essais parus aux éditions Rowohlt, Est-ce l’avènement du Troisième Reich ? de Walter Oehme et Kurt Caro et Adolf Hitler, Guillaume III de Weigand von Miltenberg. Oehme et Caro, journalistes qui quitteront l’Allemagne en 1933, demandent pourquoi un parti qui se veut socialiste se fait financer par la grande industrie donc le capitalisme, « Quelle sinistre imposture ! […] Quelle triste jeunesse ! » (p. 24) déplore Mann. Lettre à Gottfried Benn, lettre personnelle de Klaus Mann à Gottfried Benn « qui connut un bref engouement pour l’idéologie nazie entre 1933-1934 » (p. 41), qui répondit par Réponse aux écrivains en exil (diffusée à la radio le 24 mai 1933 et publiée le 26 mai 1933 dans le Deutsche Allgemeine Zeitung, et lettre publiée par Gottfried Benn dans Dopelleben en 1950). Klaus Mann questionne Gottfried Benn (auteur allemand que je ne connais pas) qui n’a pas démissionné de l’Académie dont plusieurs de ses amis, dont Heinrich Mann (l’oncle de Klaus Mann) « s’est fait honteusement renvoyer » (p. 42).
Lettre à Gottfried Benn, lettre personnelle de Klaus Mann à Gottfried Benn « qui connut un bref engouement pour l’idéologie nazie entre 1933-1934 » (p. 41), qui répondit par Réponse aux écrivains en exil (diffusée à la radio le 24 mai 1933 et publiée le 26 mai 1933 dans le Deutsche Allgemeine Zeitung, et lettre publiée par Gottfried Benn dans Dopelleben en 1950). Klaus Mann questionne Gottfried Benn (auteur allemand que je ne connais pas) qui n’a pas démissionné de l’Académie dont plusieurs de ses amis, dont Heinrich Mann (l’oncle de Klaus Mann) « s’est fait honteusement renvoyer » (p. 42). À l’intérieur et à l’extérieur, article paru en novembre 1933 dans Deutsche Stimmen. « Pour un homme intellectuellement honnête, il doit être terrible de vivre dans ce pays. Il lui faut obéir aux caprices de la force et de la confusion, et ce sans relâche. » (p. 61). « L’émigration n’est pas une aventure distrayante, et ce qui nous attend risque d’être plus difficile que tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Je me dis pourtant que notre situation est magnifique comparée à celle des humiliés de l’intérieur. » (p. 64).
À l’intérieur et à l’extérieur, article paru en novembre 1933 dans Deutsche Stimmen. « Pour un homme intellectuellement honnête, il doit être terrible de vivre dans ce pays. Il lui faut obéir aux caprices de la force et de la confusion, et ce sans relâche. » (p. 61). « L’émigration n’est pas une aventure distrayante, et ce qui nous attend risque d’être plus difficile que tout ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Je me dis pourtant que notre situation est magnifique comparée à celle des humiliés de l’intérieur. » (p. 64).






 « In memoriam James Nwoye Adichie 1932-2020 » (p. 9).
« In memoriam James Nwoye Adichie 1932-2020 » (p. 9).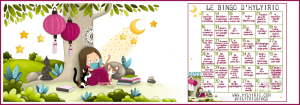 L’autrice, 42 ans, mère d’une fillette de 4 ans, vit aux États-Unis et elle est en état de choc. « Le chagrin est un enseignement cruel. On apprend combien le processus du deuil peut être brutal, combien il peut être lourd de colère. » (p. 15). Elle raconte la souffrance vécue dans son cœur et dans son corps, les sensations désagréables. « Ma colère m’effraie, ma peur m’effraie, et quelque part là-dedans il y a de la honte, aussi – pourquoi tant de rage et de frayeur en moi ? » (p. 22), c’est qu’elle ne supporte pas les messages de condoléances qui ne le réconfortent pas du tout. Il y a aussi la culpabilité de n’avoir pas été présente, d’être à l’autre bout du monde et de ne pouvoir se rendre au Nigeria car tous les aéroports sont fermés. Et pourtant parfois, avec son frère Okey resté au pays, elle rit « mais le rire est comme une braise qui ne tarde pas à flamber de douleur. » (p. 39).
L’autrice, 42 ans, mère d’une fillette de 4 ans, vit aux États-Unis et elle est en état de choc. « Le chagrin est un enseignement cruel. On apprend combien le processus du deuil peut être brutal, combien il peut être lourd de colère. » (p. 15). Elle raconte la souffrance vécue dans son cœur et dans son corps, les sensations désagréables. « Ma colère m’effraie, ma peur m’effraie, et quelque part là-dedans il y a de la honte, aussi – pourquoi tant de rage et de frayeur en moi ? » (p. 22), c’est qu’elle ne supporte pas les messages de condoléances qui ne le réconfortent pas du tout. Il y a aussi la culpabilité de n’avoir pas été présente, d’être à l’autre bout du monde et de ne pouvoir se rendre au Nigeria car tous les aéroports sont fermés. Et pourtant parfois, avec son frère Okey resté au pays, elle rit « mais le rire est comme une braise qui ne tarde pas à flamber de douleur. » (p. 39).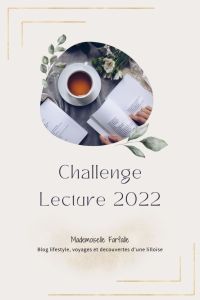 Une paragraphe qui m’interpelle. « Cet homme n’est pas un bon professeur, a-t-il dit, pas parce qu’il ne savait pas résoudre le problème, mais parce qu’il n’a pas dit qu’il ne savait pas. Est-ce pour cela que je suis devenue quelqu’un qui a assez confiance en soi pour dire ‘je ne sais pas’ quand je ne sais pas ? Mon père m’a appris qu’on n’a jamais fini d’apprendre. » (p. 52). Sur cette dernière phrase, je suis totalement d’accord mais pour ce qui est dit avant, je me demande bien, moi qui ne me sens pas confiante pourquoi je sais dire ‘je ne sais pas’.
Une paragraphe qui m’interpelle. « Cet homme n’est pas un bon professeur, a-t-il dit, pas parce qu’il ne savait pas résoudre le problème, mais parce qu’il n’a pas dit qu’il ne savait pas. Est-ce pour cela que je suis devenue quelqu’un qui a assez confiance en soi pour dire ‘je ne sais pas’ quand je ne sais pas ? Mon père m’a appris qu’on n’a jamais fini d’apprendre. » (p. 52). Sur cette dernière phrase, je suis totalement d’accord mais pour ce qui est dit avant, je me demande bien, moi qui ne me sens pas confiante pourquoi je sais dire ‘je ne sais pas’.
 Kropotkine écrit Aux jeunes gens en 1880 et le publie dans Paroles d’un révolté en 1881. Il est ensuite publié en 1904 par Temps Nouveaux, un journal anarchiste français dirigé par le militant Jean Grave (1854-1939).
Kropotkine écrit Aux jeunes gens en 1880 et le publie dans Paroles d’un révolté en 1881. Il est ensuite publié en 1904 par Temps Nouveaux, un journal anarchiste français dirigé par le militant Jean Grave (1854-1939).

 Pour les challenges
Pour les challenges  Un bon chanteur mort de Dominique A.
Un bon chanteur mort de Dominique A. « Mille raisons font que j’écris des chansons. » (p. 5).
« Mille raisons font que j’écris des chansons. » (p. 5).
 « Un rien suffit à faire naître une chanson : un son, un accord, une programmation mambo ou fox-trot que je n’ai pas encore utilisée. J’aime le son pauvre que ça produit, son absence de clinquant, en rapport avec le détachement de la voix, que je veux blanche et sèche, sans pathos, sans interprétation, sans effet flatteur de réverbération. » (p. 32). Voilà, c’est ça que j’aime dans la voix, dans les musiques et les chansons de Dominique A ! La simplicité, le dépouillement quasiment, l’effet brut « et ce qui en résulte peut être intense et beau » (p. 42) : tout à fait, ses textes sont très beaux, sa musique est très belle, et je ressens toujours une grande intensité, une grande émotion à l’écoute de ses chansons qu’elles soient minimalistes, romantiques, intimes (ou même morbides pour certaines) mais toujours avec une ambiance rock. D’ailleurs, je vous mets une petite sélection ci-dessous ; écoutez Dominique A !
« Un rien suffit à faire naître une chanson : un son, un accord, une programmation mambo ou fox-trot que je n’ai pas encore utilisée. J’aime le son pauvre que ça produit, son absence de clinquant, en rapport avec le détachement de la voix, que je veux blanche et sèche, sans pathos, sans interprétation, sans effet flatteur de réverbération. » (p. 32). Voilà, c’est ça que j’aime dans la voix, dans les musiques et les chansons de Dominique A ! La simplicité, le dépouillement quasiment, l’effet brut « et ce qui en résulte peut être intense et beau » (p. 42) : tout à fait, ses textes sont très beaux, sa musique est très belle, et je ressens toujours une grande intensité, une grande émotion à l’écoute de ses chansons qu’elles soient minimalistes, romantiques, intimes (ou même morbides pour certaines) mais toujours avec une ambiance rock. D’ailleurs, je vous mets une petite sélection ci-dessous ; écoutez Dominique A !